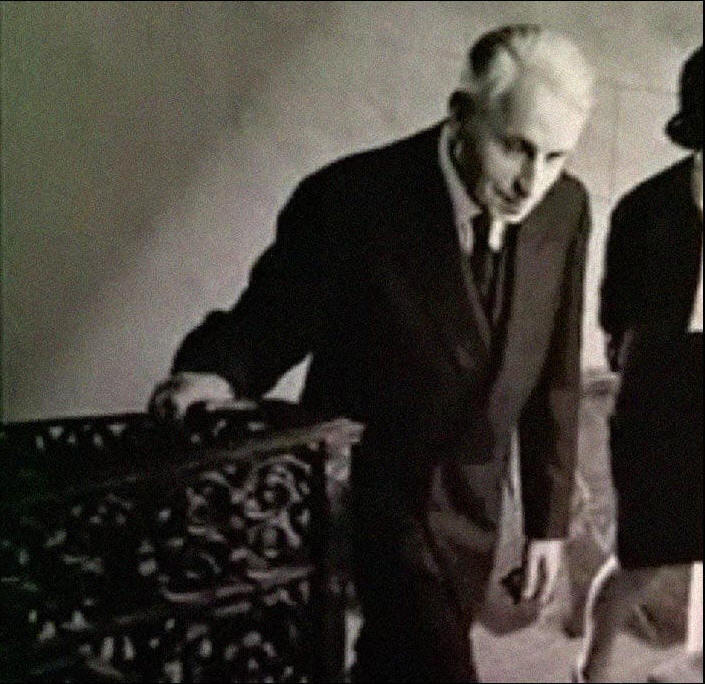Le travail: une satisfaction différée
Le travail exige une conduite où le calcul de l'effort,
rapporté à l'efficacité productive, est constant. Il existe une conduite
raisonnable, où les mouvements tumultueux qui se délivrent dans la fête et,
généralement, dans le jeu, ne sont pas de mise. Si nous ne pouvions refréner
ces mouvements, nous ne serions pas susceptibles de travail, mais le travail
introduit justement la raison de les refréner. Ces mouvements donnent à ceux
qui leur cèdent une satisfaction immédiate: le travail, au contraire, promet
à ceux qui les dominent un profit ultérieur, dont l'intérêt ne peut être
discuté, sinon du point de vue du moment présent (…)
Il est arbitraire, sans doute, de toujours opposer le détachement, qui est à
la base du travail, à des mouvements tumultueux dont la nécessité n'est pas
constante. Le travail commencé crée néanmoins une impossibilité de répondre
à ces sollicitations immédiates, qui peuvent nous rendre indifférents à des
résultats souhaitables, mais dont l'intérêt ne touche que le temps
ultérieur. La plupart du temps, le travail est l'affaire d'une collectivité,
et la collectivité doit s'opposer, dans le temps réservé au travail, à ces
mouvements d'excès contagieux dans lesquels rien n'existe plus que l'abandon
immédiat à l'excès. C'est-à-dire la violence. Aussi bien la collectivité
humaine, en partie consacrée au travail, se définit-elle dans les interdits
sans lesquels elle ne serait pas devenue ce monde du travail qu'elle est
essentiellement.
L'homme: être de la double négation
Je pose en principe un fait peu contestable: que l'homme
est l'animal qui n'accepte pas simplement le donné naturel, qui le nie. Il
change ainsi le monde extérieur naturel, il en tire des outils et des objets
fabriqués qui composent un monde nouveau, le monde humain. L'homme
parallèlement se nie lui-même, il s'éduque, il refuse par exemple de donner
à la satisfaction de ses besoins animaux ce cours libre, auquel l'animal
n'apporte pas de réserve. Il est nécessaire encore d'accorder que les deux
négations que, d'une part, l'homme fait du monde donné et, d'autre part, de
sa propre animalité, sont liées. Il ne nous appartient pas de donner une
priorité à l'une ou à l'autre, de chercher si l'éducation (qui apparaît sous
la forme des interdits religieux) est la conséquence du travail, ou le
travail la conséquence d'une mutation morale. Mais en tant qu'il y a homme,
il y a d'une part travail et de l'autre négation par interdits de
l'animalité de l'homme.
la conscience de l’objet s’est faite au détriment de la conscience de
soi
Ce que nous appelons le monde humain est nécessairement un
monde du travail, c’est-à-dire de la réduction. Mais le travail a un autre
sens que la peine, que le chevalet de torture que l’étymologie l’accuse
d’être. Le travail est aussi la voie de la conscience, par laquelle l’homme
est sorti de l’animalité. C’est par le travail que la conscience claire et
distincte des objets nous fut donnée, et la science est toujours demeurée la
compagne des techniques. L’exubérance sexuelle au contraire nous éloigne de
la .conscience; elle atténue en nous la faculté de discernement: d’ailleurs
une sexualité librement débordante diminue l’aptitude au travail, de même
qu’un travail soutenu diminue la faim sexuelle. Il y a donc entre la
conscience, étroitement liée au travail et la vie sexuelle, une
incompatibilité dont la rigueur ne saurait être niée. Dans la mesure où
l’homme s’est défini par le travail et la .conscience;, il dut non seulement
modérer, mais méconnaître et parfois maudire en lui-même l’excès sexuel. En
un sens, cette méconnaissance a détourné l’homme sinon de la .conscience;
des objets, du moins de la conscience de soi. Elle l’a engagé en même temps
dans la conscience du monde et dans l’ignorance de soi. Mais, s’il n’était
d’abord devenu conscient en travaillant, il n’aurait pas de connaissance du
tout: il n’y aurait encore que la nuit animale.