 Le mythe de
l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux la tête de l'abbé. C'est une belle
tête, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat : le regard
bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la
canadienne du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les
chiffres de la légende et ceux de la modernité.
Le mythe de
l'abbé Pierre dispose d'un atout précieux la tête de l'abbé. C'est une belle
tête, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat : le regard
bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire, tout cela complété par la
canadienne du prêtre-ouvrier et la canne du pèlerin. Ainsi sont réunis les
chiffres de la légende et ceux de la modernité.
La coupe de cheveux, par exemple, à moitié rase, sans
apprêt et surtout sans forme, prétend certainement accomplir une coiffure
entièrement abstraite de l'art et même de la technique, une sorte d'état
zéro de la coupe ; il faut bien se faire couper les cheveux, mais que cette
opération nécessaire n'implique au moins aucun mode particulier d'existence
: qu'elle soit, sans pourtant être quelque chose. La coupe de l'abbé Pierre,
conçue visiblement pour atteindre un équilibre neutre entre le cheveu court
(convention indispensable pour ne pas se faire remarquer) et le cheveu
négligé (état propre à manifester le mépris des autres conventions) rejoint
ainsi l'archétype capillaire de la sainteté : le saint est avant tout un
être sans contexte formel ; l'idée de mode est antipathique à l'idée de
sainteté.
Mais où les choses se compliquent - à l'insu de l'abbé, il
faut le souhaiter - c'est qu'ici comme ailleurs, la neutralité finit par
fonctionner comme signe de la neutralité, et si l'on voulait vraiment passer
inaperçu, tout serait à recommencer. La coupe zéro, elle, affiche tout
simplement le franciscanisme ; conçue d'abord négativement pour ne pas
contrarier l'apparence de la sainteté, bien vite elle passe à un mule
superlatif de signification, elle déguise l'abbé en rouit François. D'où la
foisonnante fortune iconographique de cette coupe dans les illustrés et au
cinéma (où il suffira à l'acteur Reybaz de la porter pour se confondre
absolument avec l'abbé).
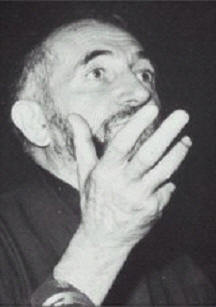 Même circuit
mythologique pour la barbe : sans doute peut-elle être simplement l'attribut
d'un homme libre, détaché des conventions quotidiennes de notre monde et qui
répugne à perdre le temps de se raser : la fascination de la charité peut
avoir raisonnablement ces sortes de mépris ; mais il faut bien constater que
la barbe ecclésiastique a elle aussi sa petite mythologie. On n'est point
barbu au hasard, parmi les prêtres ; la barbe y est surtout attribut
missionnaire ou capucin, elle ne peut faire autrement que de signifier
apostolat et pauvreté ; elle abstrait un peu son porteur du clergé séculier
; les prêtres glabres sont censés plus temporels, les barbus plus
évangéliques : l'horrible Frolo était rasé, le bon Père de Foucauld barbu ;
derrière la barbe, on appartient un peu moins à son évêque, à la hiérarchie,
à l'Église politique ; on semble plus libre, un peu franc-tireur, en un mot
plus primitif, bénéficiant du prestige des premiers solitaires, disposant de
la rude franchise des fondateurs du monachisme, dépositaires de l'esprit
contre la lettre : porter la barbe, c'est explorer d'un même cœur la Zone,
la Britonnie ou le Nyassaland.
Même circuit
mythologique pour la barbe : sans doute peut-elle être simplement l'attribut
d'un homme libre, détaché des conventions quotidiennes de notre monde et qui
répugne à perdre le temps de se raser : la fascination de la charité peut
avoir raisonnablement ces sortes de mépris ; mais il faut bien constater que
la barbe ecclésiastique a elle aussi sa petite mythologie. On n'est point
barbu au hasard, parmi les prêtres ; la barbe y est surtout attribut
missionnaire ou capucin, elle ne peut faire autrement que de signifier
apostolat et pauvreté ; elle abstrait un peu son porteur du clergé séculier
; les prêtres glabres sont censés plus temporels, les barbus plus
évangéliques : l'horrible Frolo était rasé, le bon Père de Foucauld barbu ;
derrière la barbe, on appartient un peu moins à son évêque, à la hiérarchie,
à l'Église politique ; on semble plus libre, un peu franc-tireur, en un mot
plus primitif, bénéficiant du prestige des premiers solitaires, disposant de
la rude franchise des fondateurs du monachisme, dépositaires de l'esprit
contre la lettre : porter la barbe, c'est explorer d'un même cœur la Zone,
la Britonnie ou le Nyassaland.
Évidemment, le problème n'est pas de savoir comment cette
forêt de signes a pu couvrir l'abbé Pierre (encore qu'il soit à vrai dire
assez surprenant que les attributs de la bonté soient des sortes de pièces
transportables, objets d'un échange facile entre la réalité, l'abbé Pierre
de Match, et la fiction, l'abbé
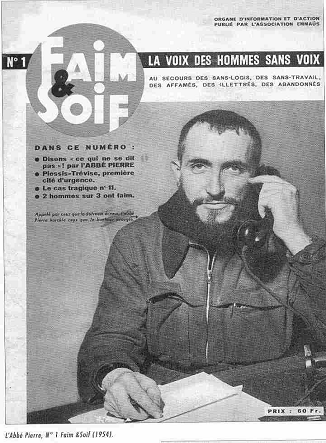 Pierre du film,
et qu'en un mot l'apostolat se présente dès la première minute tout prêt,
tout équipé pour le grand voyage des reconstitutions et des légendes). Je
m'interroge seulement sur l'énorme consommation que le public fait de ces
signes. Je le vois rassuré par l'identité spectaculaire d'une morphologie et
d'une vocation ; ne doutant pas de l'une parce qu'il connaît l'autre ;
n'ayant plus accès à l'expérience même de l'apostolat que par son
bric-à-brac et s'habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin
de la sainteté ; et je m'inquiète d'une société qui consomme si avidement
l'affiche de la charité qu'elle en oublie de s'interroger sur ses
conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me demander si
la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont
une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de plus, pour substituer
impunément les signes de la charité à la réalité de la justice.
Pierre du film,
et qu'en un mot l'apostolat se présente dès la première minute tout prêt,
tout équipé pour le grand voyage des reconstitutions et des légendes). Je
m'interroge seulement sur l'énorme consommation que le public fait de ces
signes. Je le vois rassuré par l'identité spectaculaire d'une morphologie et
d'une vocation ; ne doutant pas de l'une parce qu'il connaît l'autre ;
n'ayant plus accès à l'expérience même de l'apostolat que par son
bric-à-brac et s'habituant à prendre bonne conscience devant le seul magasin
de la sainteté ; et je m'inquiète d'une société qui consomme si avidement
l'affiche de la charité qu'elle en oublie de s'interroger sur ses
conséquences, ses emplois et ses limites. J'en viens alors à me demander si
la belle et touchante iconographie de l'abbé Pierre n'est pas l'alibi dont
une bonne partie de la nation s'autorise, une fois de plus, pour substituer
impunément les signes de la charité à la réalité de la justice.
![]()