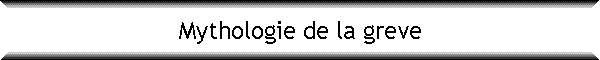
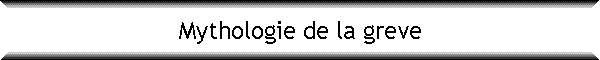
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
Ce qui se conçoit bien
s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément.
Que n'a-t-on dit? Que ne dira-t-on encore. Les médias s'en donnent à cœur joie et les mots viennent aisément pour la dire - ou dénoncer - comme s'il s'agissait d'une scandaleuse évidence. Et les mots, toujours les mêmes, fusent: galère, otage, usager, la débrouille... GrèveCurieusement, le mot renvoie à la fois à la plage et au labeur, mais dans les deux cas, à la vacuité. La grève, en réalité est une limite comme la plage la ligne extrême que la terre finissante concède aux flots. Ici, sur cette place , on venait chercher du travail et, derechef, la grève signale une limite : la forme extrême de la précarité. La grève est une antithèse, le négatif photographique de l'ordre: ce qui nous fait brusquement basculer dans un autre monde et qui bouscule. On a peine à imaginer grève sage et ordonnée même si c'est ici le rêve de tous les bien-pensants! Elle est, sans doute, la pointe avancée de l'ordre dans le désordre, la concession que l'institution néglige aux exclus. Mais parce qu'elle est cette ligne, imaginaire au moins autant que virtuelle, la grève fonctionne en même temps comme un exutoire, permettant à l'ordre d'être supportable. Sans doute peut-on écrire de la grève ce que Caillois écrivait à propos de la fête : ce moment où le profane frôle le sacré ! C'est bien pour cela qu'il ne faut jamais la prendre à la légère puisqu'elle réinvente, souvent dans la douleur, quelque chose du rêve et de la rencontre, cette part de socialité mythique où la rencontre de l'autre redevient possible, cette nostalgie des anges où l'illusion est si suave d'enfin pouvoir agir sur le réel. Car la grève, c'est ceci aussi : l'illusion sinon du pouvoir en tout cas de l'action. Le point de jointure entre sacré et profane se trouve ici: dans l'ordre ordinaire du quotidien domine surtout le sentiment d'impuissance et la certitude que finalement nous sommes trop isolés pour parvenir jamais à influer sur le cours ordinaire des choses. L'instant de la grève c'est au contraire le sentiment de reprendre son destin en main et de pouvoir sinon rompre du moins distordre la chaîne des déterminismes. Mais dira-t-on, la grève est un rapport de forces, la tension désormais visible entre protagonistes que tout oppose ! Mais n'était-ce pas déjà le cas de ces journaliers quémandant, plutôt que l'obole, la grâce du labeur, la chance d'être libre, l'honneur d'être un homme. Même chantage, même déséquilibre entre les protagonistes où le premier s'insurge précisément de n'avoir aucune carte en main que monopolise l'autre. L'insurrection est précisément la conséquence de ce déséquilibre-ci: faute de pouvoir négocier, échanger, il ne reste plus au journalier que d'attendre ou se révolter. Condamné à l'extrême ou à la disparition, au brouhaha de la foule ou au silence du renoncement ! Au même titre que la révolution, la grève signe cet instant prodigieusement dangereux des fondations : n'oublions pas, et ceci est vrai des institutions tant politiques que sociales, combien notre système est représentatif, et ne parvient en conséquence à fonctionner qu'autant que le représenté soit symbolisé par son mandataire, qu'autant que ce mandant soit absent ! La grève, qui est la forme extrême du débat, voit surgir le mandant, qui bouscule les codes et impose sa volonté - ou le tente ! Et l'on voudrait que ceci se passe bien ! Serions-nous désormais à ce point aseptisés par la partouze communicationnelle que nous ne supportions plus aucune autre violence que celle représentée dans la série B dont TF1 nous abreuve ? aurions-nous oublié que le politique ne parvient jamais à l'abolition de la violence mais suscite seulement sa canalisation qu'il manque, d'ailleurs, à chaque moment de rater; qu'il rate chaque fois que la contrainte qu'il exerce est plus forte que la sécurité qu'il prodigue, que la transaction se fait trop évidemment à la défaveur du contractant !
Jaurès paya de sa vie l'impossible grève contre la guerre et, de loin en loin, les grèves épisodiques ne sont plus là que pour symboliser un rapport de force, que pour marquer un territoire. C'est bien ici, dans cet entrelacs que se joue l'actualité: réel et représentation s'entrecroisent à s'y méprendre. Ce que nous venons de vivre, ce que les médias ne supportent pas pour le fustiger ainsi dans ces interminables et incantatoires récriminations, c'est précisément le retour du refoulé . Or ce refoulé a un forme: celle du réel. Il a un nom : classe ouvrière. GalèreOn se joue ici d'une figure aisée, celle d'une barbarie dépassée. Nous voici galériens, condamnés à des efforts insupportables et, au reste, insupportés. De manière inique ! Ici encore le discours est biaisé ! On ne saurait imaginer grève qui ne gênât point ! Pour être efficace, il faut savoir peser dans un rapport : s'il est dialectique, il faut que l'argument vaille; s'il est stratégique il faut être un danger, une menace ! On ne pèse pas avec rien ! Mais dire galère renvoie sinon à l'esclavage en tout cas à l'aliénation et ceci est bien plus révélateur! Tout se passe comme si les médias ne nous considéraient jamais que comme les sujets d'une histoire que nous subirions. Non plus comme des citoyens mais des sujets d'un Ancien Régime qui nous eût banni de son territoire par le seul fait du Prince ! De là à ce que l'on nous réinvente les lettres de cachets ! Le plus ironique en l'affaire tient à ce que l'on nous trouve galérien lorsque nous sommes entravés dans notre capacité à travailler. La modernité nous réinvente le Arbeit macht frei : réduits au grade de fourmis laborieuses, ne conquérant la dignité de l'existence que par le travail, réduits au néant sitôt que l'on en serait privé! On se moquait à la fin des années 60 su boulot, métro, dodo , on dirait bien que désormais ce qui pose problème ce n'est plus cette litanie-ci mais l'absence des deux premiers termes qui nous empêche de nous laisser glisser dans le troisième ! Je crois bien que la véritable aliénation est cet aveuglement qui nous fait prendre pour agression la révolte de l'autre dont nous ne remarquons même plus qu'elle est la nôtre aussi, ou, du moins devrait l'être. La voix de son maître est désormais à ce point tonitruante que nous n'entendons plus qu'elle et ne prenons plus fait et cause que pour elle. Fourmis isolées, atomisées dans ce maelstrom invraisemblable, prêtes à être écrasées ! Le discours des possédants, décidément, est obscène ! OtageLe mot est fort parce que depuis les années quarante, le terme a revêtu une connotation d'horreur et de barbarie. Au lieu d'être seulement l'instrument d'un troc, d'une transaction lors d'un conflit, l'otage devient la victime d'un odieux chantage, celui d'une répression implacable. Mais le mot qui vient de hôte est manifestement ambivalent : au même titre qu'hôte signifie à la fois l'invitant et l'invité; qu'hospitis et hostis ont la même origine, l'otage est invité involontaire. Un parasite au moins autant qu'un parasité ! Il est ici la monnaie du chantage exercé, en tout cas la monnaie d'échange ! Cependant, user de ce terme n'est pas anodin : c'est à peu près déplacer la grève du côté de la terreur . De la même manière que le terrorisme consiste pour résoudre un conflit de porter la guerre hors de son territoire normal et de s'en prendre non pas à son adversaire mais à une population extérieure en soi au différend; de la même manière, la grève consisterait à déplacer le conflit hors de sa zone naturelle, à s'en prendre à des innocents .... C'est supposer deux choses:
Mais l'ambivalence va son train : user de ce terme est aussi une manière de dire que l'on serait ici entré dans un conflit allant au delà des corporatismes locaux pour embrasser un antagonisme bien plus radical. L'heure est alors à la résistance face à un ennemi radical ! En serions-nous là? Mais alors il faut prendre la mesure de ce qui se passe et se dire que c'est une guerre qui commence où chacun risque bien d'aller au terme de ses forces, à l'extrême de sa puissance de destruction ! Conflit métaphysique? Eschatologique ! DébrouilleL'art de l'expédient est d'origine militaire et la langue usuelle retrouve sans le savoir les traverses militaires. De ce point de vue expédients s'oppose à otage: celui-ci vous laisse supposer être étranger au conflit; le militaire ne laisse jamais personne à l'extérieur et l'on finit toujours pas être contraint de prendre parti. L'otage est victime, non consentante, mais silencieuse; avec la guerre, même le civil est contraint de prendre parti et en tout cas de subir . Se débrouiller, vivre d'expédients : passer son effort à écarter les obstacles ! Nous voici ramenés au lot commun du biffin : pris en charge par l'institution, en quasi perte d'identité, soumis à l'uniforme et à la volonté générale; pion sur un échiquier où il n'y a pas de règles. L'état social était supposé mettre fin à l'état de guerre de tous contre chacun. Et bien non! il nous y ramène incontinent! toujours! La grève nous rappelle une des facette de l'être : la dialectique! |
|
Étymol. et Hist. 1805 (Rapp. 5 prair. an XIII − 25 mai 1805, Aul., Par ... Emp., t. I, p. 801 ds Brunot t. 9, p. 1183, note 7 : Les tailleurs de pierre ont décidé entre eux de faire, demain lundi, ce qu'ils appellent « grève » [c'est-à-dire de quitter l'ouvrage] pour demander de l'augmentation). Du nom de la place de Grève à Paris, au bord de la Seine (actuelle place de l'Hôtel de Ville), (1260, E. Boileau, Métiers, éd. J.-B. Depping, p. 15) où se réunissaient les ouvriers sans travail, en attendant l'embauche.
OTAGE,
subst. masc.
DÉBROUILLE, subst.
fém. voir Sophie Wahnich, la liberté ou la mort , notamment p 941 ce qui suscita la fameuse réplique de Jaurès à la chambre : Pas çà ou pas vous : |