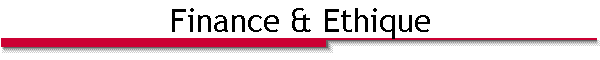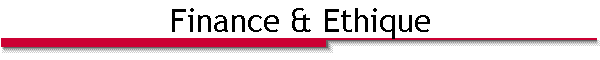A
réflexion sur les rapports de l'éthique et de la finance nous est imposée
par l'actualité : scandales boursiers, avec leurs enrichissements rapides
sans autre cause apparente que l'accès privilégié à une information
réservée ; argent de la drogue blanchi dans tous les paradis fiscaux de la
planète ; mobilisation de sommes énormes autour d'opérations qui
paraissent plus financières qu'économiques ou industrielles ; volumineuses
dettes des pays du tiers-monde, mais aussi des Etats-Unis ; spéculations
effrénées sur des valeurs (monnaies et titres divers) qui semblent avoir
perdu toute norme.
A
réflexion sur les rapports de l'éthique et de la finance nous est imposée
par l'actualité : scandales boursiers, avec leurs enrichissements rapides
sans autre cause apparente que l'accès privilégié à une information
réservée ; argent de la drogue blanchi dans tous les paradis fiscaux de la
planète ; mobilisation de sommes énormes autour d'opérations qui
paraissent plus financières qu'économiques ou industrielles ; volumineuses
dettes des pays du tiers-monde, mais aussi des Etats-Unis ; spéculations
effrénées sur des valeurs (monnaies et titres divers) qui semblent avoir
perdu toute norme.
Il parait opportun d'argumenter le dossier des rapports
entre l'éthique et la finance, tant il est vrai que si l'éthique
appréhende difficilement le monde de la finance, ce dernier apparait peu
ouvert à l'éthique.
Par éthique, j'entends ici l'agir humain en tant qu'il se
donne un sens, c'est-à-dire à la fois une direction et une signification,
la façon dont chacun fonde ce sens au point de vue philosophique ou
religieux restant ouverte et plurielle. L'éthique se distingue donc de la
morale, qui est le domaine des interdictions et des obligations. Elle ne
s'identifie pas aux déontologies, qui sont les morales particulières des
professions.
Le philosophe Paul Ricœur caractérise très bien l'éthique
lorsqu'il la définit comme " le désir d'une vie accomplie, qui fonde
l'estime de soi-même, avec et pour les autres, dans le cadre
d'institutions justes " (1).
En matière d'économie, le vieux fonds éthique de la
civilisation occidentale intègre avec difficulté toutes les dimensions de
l'échange. Aristote considère l'économie comme l'autoproduction des biens
et des services nécessaires à une communauté, l'échange n'étant qu'un
reliquat. Pour lui, une économie orientée vers l'échange est une
corruption de l'économie, une chrématistique, c'est-à-dire un
enrichissement dépourvu de sens. Le prêt à intérêt est interdit comme
anti-naturel, puisque l'argent ne fait pas de petits.
La même condamnation est portée par le judaïsme, par
l'islam et par le christianisme, avec des justifications identiques
complétées de considérations religieuses. Il est curieux de retrouver dans
l'analyse faite par Marx sur la valeur d'échange et l'extorsion de
plus-value la même référence au texte fondateur d'Aristote. Le commerce
n'est pas bien vu par un Thomas d'Aquin, qui le considère comme une
occasion de péché, et le commerce de l'argent est en lui-même condamné.
Qui affirmera que, même anciennes, de telles conceptions de la finance ne
pèsent en rien sur les mentalités d'aujourd'hui ?
Le monde de la finance s'est considérablement développé à
partir du seizième siècle, avec l'expansion du capitalisme commercial.
Dans sa nouveauté, sa mobilité et sa complexité, le discernement éthique
n'était pas aisé. Tandis que les théologiens catholiques s'accrochaient au
principe de la condamnation du prêt à intérêt, quitte à multiplier les
exceptions excusantes d'une pratique qui se généralisait, Calvin
introduisait une distinction remarquable entre le prêt à la consommation,
qui devait rester gratuit, et le prêt à l'entreprise, qui, participant de
la production de nouvelles richesses, pouvait légitimement donner lieu à
une rémunération spécifique.
Le discernement éthique est devenu aujourd'hui encore
plus difficile, à l'âge de l'ingénierie financière et de l'activité
bancaire multiforme. Que penser des OPA et comment distinguer entre celles
qui sont pur jeu d'argent et celles qui correspondent à des opérations de
recomposition industrielle nécessaires à la modernisation de l'activité et
susceptibles de mobiliser un collectif de salariés ? Quel attachement au
projet d'une entreprise et à sa culture, lorsque les salariés savent qu'un
coup de Bourse peut modifier en un instant la propriété du capital et la
personnalité des dirigeants ?
Embué de convictions et tourné vers le long terme, le
regard éthique s'ajuste mal à l'incertitude de la finance et à son extrême
mobilité. Avec les cotations en continu, toute information est dépassée au
moment même où elle est communiquée. Dans un jeu aussi rapide, comment
assurer l'équité dans l'accès à l'information ? L'activité spéculative
répugne à l'éthique et, pourtant, elle semble indispensable à la gestion
des trésoreries dans l'état actuel du marché des changes. Le jeu
spéculatif apparait aussi nécessaire comme contrepartie de la spéculation
assurance et si le jeu n'est pas de soi immoral, son absence de finalité
hors du jeu lui-même le met hors jeu de l'éthique.
L'argent des autres
La finance constitue ainsi pour l'éthique un monde
difficile à appréhender. Est-elle un monde fermé à l'éthique ? Banquiers
et financiers, eux dont l'activité professionnelle repose sur la
confiance, disposent d'un argument en béton pour refuser tout
questionnement éthique suscité de l'extérieur : " L'argent avec lequel
nous travaillons est l'argent des autres. "
A partir de cette affirmation, qui est très largement
vraie, s'organise un argumentaire du déni de responsabilité : ce sont nos
clients qui exigent que leur argent soit employé avec le maximum de
sécurité ; ce sont les entreprises qui font appel à nous pour assurer leur
trésorerie et financer leurs projets ; c'est l'État qui décide de la
réglementation de notre activité et qui enserre étroitement l'exercice de
notre profession ; c'est la concurrence qui nous contraint à agir de la
sorte... L'expérience faite du dialogue entre financiers et éthiciens
vérifie à la fois la permanence de ce plaidoyer et la frustration des
parties prenantes d'un tel échange (2).
Si le questionnement éthique venant de l'extérieur est
refusé, toute morale n'est pas exclue de la finance : la profession s'est
même forgé une déontologie forte (la parole d'un banquier l'engage sans
recours à l'écrit par exemple). Néanmoins, on se demande parfois si elle
ne connait pas quelque affaissement. Mais, je l'affirmais en commençant,
la déontologie n'est pas l'éthique. Toute nécessaire qu'elle soit, elle
relève de ce que le philosophe Bergson appelait la morale close, par
rapport à cette morale ouverte qu'est l'éthique.
Des lieux de communication
Peut-on sortir de l'impasse de ce double procès ? Je
crois que des pistes existent. En novembre 1987 s'est tenu à Paris, à
l'initiative de l'épiscopat catholique, de la Fédération protestante et
d'un collectif d'organisations non gouvernementales de développement, un
colloque sur la dette du tiers-monde proposant un code de bonne conduite
en matière de prêts à ces pays. Ce dialogue remarquable entre financiers
responsables et militants de diverses confessions religieuses et tendances
politiques a permis de faire progresser la conscience de tous sur le sujet
(3). Autre exemple : sous la pression de congrégations religieuses et de
militants tiers-mondistes, certaines banques ont lancé des produits
financiers éthiques : les portefeuilles d'OPCVM excluaient les
participations dans des activités aux finalités douteuses du point de vue
de la sauvegarde de la paix, de la morale et de l'environnement.
Paul Ricœur soulignait l'importance des institutions
justes pour la promotion de l'éthique. De ce point de vue s'impose la
réforme du système monétaire international. La réalisation du système
monétaire européen revêt à cet égard une réelle portée éthique.
L'amélioration des règles de surveillance des opérations boursières
constitue un effort de même nature.
Le développement d'études de cas d'éthique des affaires
dans les écoles de commerce, pourvu qu'elles soient menées hors de
l'esprit trop utilitariste qui préside la plupart du temps aux " business
ethics " à l'américaine et dans un souci très ouvert de communication,
peut aider à une montée de conscience dans le monde de la finance, tout en
sachant ne pas céder à l'illusion socratique selon laquelle il suffit
d'enseigner la vertu pour qu'elle soit pratiquée.
Animer des lieux de communication éthique devrait être le
souci de tous ceux qui ne prennent pas leur parti de la rupture entre
éthique et finance. Pour avoir fréquenté et parfois suscité de tels lieux,
j'en connais la difficulté et l'inconfort, mais aussi la force et la
portée.
PUEL HUGUES