

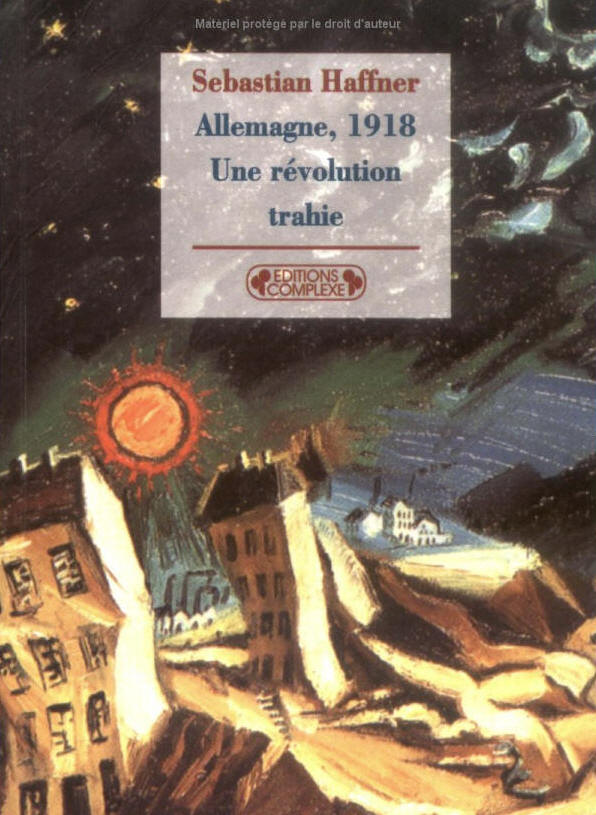 |
Sebastian Haffner,
|
| ... au cirque Busch. C’est là que la révolution livra sa première grande
bataille et la perdit. Première et pourtant déjà décisive : sa bataille de
la Marne. Le samedi 9 avait été le point culminant de cette vague révolutionnaire improvisée et sans chefs, née le lundi précédent à Kiel. Le dimanche 10 préparait son échec. Mais, paradoxalement, ce qui scellerait sa défaite apparut ce jour-là, de l’extérieur, comme son plus grand triomphe. Le matin, rien n’était encore joué. Les rues du centre ville, qui la veille avaient vu déferler une marée humaine, s’étendaient, vides et tranquilles. On voyait encore flotter des drapeaux rouges Unter den Linden [1], mais bien peu de promeneurs étaient là pour s’en réjouir ou s’en offusquer. Les ouvriers, qui la veille à la même heure avaient entamé leur marche révolutionnaire, étaient, en ce dimanche matin, presque tous retournés dans leurs usines pour élire leurs conseils qui allaient instituer l’après-midi, au cirque Busch, le gouvernement de la révolution victorieuse. C’était une brillante performance organisationnelle des Délégués révolutionnaires, qui n’avaient pris cette décision que la veille au soir. Le mot d’ordre avait volé de bouche en bouche, et les travailleurs étaient presque au complet dans les usines pour voter. Mais ils ne votèrent pas selon les vœux des Délégués révolutionnaires. Le SPD n’avait pas chômé non plus, cette nuit-là. Des milliers de tracts avaient été rédigés en hâte, imprimés et distribués. Le Vorwärts passait de main en main dans les usines, ou bien les ouvriers en lisaient un exemplaire à voix haute, en groupe. On écoutait, on hochait gravement la tête. En première page, le titre : « Pas de combat fratricide ! ». Cela frappait génialement juste. C’était exactement l’état d’esprit général. Celui-ci avait changé, et les Délégués révolutionnaires ne l’avaient pas pressenti. Hier il était rageur, impatient, prêt à l’émeute, plein d’une sombre détermination et d’un ressentiment longtemps étouffé, tout près de l’explosion : bref, révolutionnaire. Aujourd’hui il était relâché, disposé à la générosité et à la réconciliation. Il régnait une atmosphère de victoire, non pas dans le sens d’une ivresse, mais d’un sentiment de gratitude. Chacun se sentait reconnaissant de ce que la victoire ait été aussi facile, que l’on n’ait pas eu à se battre, qu’il n’y ait eu ni victime ni violence. Tous ceux qui, la veille, avaient marché vers le centre, prêts à donner leur vie, avaient l’impression d’en avoir reçu une neuve en cadeau. Richard Müller, l’un des dirigeants des Délégués révolutionnaires, raconte que, dans certaines usines, les permanents du SPD, qui la veille encore se seraient fait écharper et jeter dehors parce qu’ils refusaient de se joindre à la manifestation, se voyaient aujourd’hui élire dans les conseils.
Si le vote des usines fut une défaite partielle, c’en fut une complète dans les casernes. Là les Délégués révolutionnaires n’avaient absolument pas leur mot à dire : ils n’y connaissaient personne. C’est Otto Wels qui avait la parole, et il tenait un langage agressif : ici, pas question de réconciliation, de fraternisation, non. Il s’agissait de faire échouer un sombre complot visant à expulser le SPD du gouvernement par surprise. Les soldats ne s’étaient-ils pas, la veille, sans considération de parti, rangés du côté du peuple ? Ils avaient donc aujourd’hui le devoir de défendre le droit du peuple. Ils devaient se mettre à la disposition du gouvernement d’Ebert et Scheidemann. Hier, les chasseurs de Naumburg leur avaient montré la voie ! Tempête de hourras. On décida de créer un comité d’action des troupes de Berlin. A midi, un meeting de soldats (des élus et des non élus) eut lieu dans la cour du Vorwärts, on désigna des responsables et des orateurs, on reçut du ravitaillement et, bien avant l’heure à laquelle l’assemblée des conseils était convoquée, les soldats se mirent en marche, Wels à leur tête, vers le cirque Busch, où ils occupèrent les rangées du bas, les plus proches de la piste. Hermann Müller, qui sera plus tard Chancelier SPD, raconte une anecdote qui éclaire indirectement l’état d’esprit de ce cortège : « Un spartakiste qui s’était joint par curiosité au cortège des soldats comprit ce qui se préparait et cria, en menaçant Wels de son revolver : "Salaud, tu vas tout gâcher !" Il ne tira pas, et c’est pourquoi il ne fut pas lynché. » Ainsi se préparaient, dans les usines et les casernes, la défaite de la révolution et la victoire d’Ebert. Mais celui-ci n’en savait encore rien. Il voyait se dresser devant lui l’épreuve du cirque Busch, comme un dompteur à l’instant de sa première entrée dans la cage aux lions. Il ne se sentirait prêt à l’affronter qu’une fois en mesure de présenter une coalition avec les indépendants, autrement dit un gouvernement de la réunification social-démocrate. Tandis que l’on discutait et votait dans les usines et les casernes, le gouvernement du Reich - qui était toujours, à son président près, celui du prince Max, c’est-à-dire à moitié constitué de partis bourgeois - siégeait à la Chancellerie, sous la présidence d’Ebert ; et, au Reichstag, se réunissait à nouveau le groupe parlementaire USPD. Ici et là, on débattait du remaniement gouvernemental. Il y avait bien aussi à l’ordre du jour la question de l’acceptation ou non des conditions d’armistice, mais ce point fut vite réglé car la décision ne faisait aucun doute. Les conditions étaient dures et mettaient l’Allemagne dans l’impossibilité de continuer à se battre, mais il était clair depuis le 29 septembre qu’elle n’en était plus capable. Le Commandement suprême avait envoyé un télégramme demandant qu’on tente d’obtenir des allégements mais que l’on signe même si l’on n’y parvenait pas. « Prions le gouvernement de prendre au plus vite décision en ce sens. Von Hindenburg. » Ce qui fut fait. Erzberger [2], qui passa toute cette journée, à Compiègne, à attendre nerveusement la réponse, raconte qu’il reçut en fin de journée une dépêche ouverte qui lui donnait tout pouvoir de signer, « ce qui m’affecta énormément, car le résultat de mes deux jours de négociation se trouvait gravement compromis par le fait d’une dépêche ouverte » (il devait réussir néanmoins à arracher quelques adoucissements). « La dépêche était signée "Reichskanzler Schluss". L’officier interprète demanda si "Schluss" était le nom du nouveau Chancelier, et qui était ce monsieur, car il était totalement inconnu du haut commandement comme du gouvernement français. Je dus expliquer que "Schluss" devait se comprendre comme "point final". » Mais tout cela était pour ainsi dire accessoire. L’acceptation des conditions d’armistice n’était plus une vraie question. Ce qui occupait Ebert en cette matinée, c’était la décision des indépendants et, dans la situation où il se trouvait, il était tout aussi disposé à en passer par leurs conditions que par celles de l’ennemi. Car il avait aussi désespérément besoin des indépendants que l’Allemagne de la cessation des hostilités ; du moins le croyait-il. Avec un gouvernement de réconciliation social-démocrate, il se sentait maître de la situation ; sans, il ne savait pas comment tournerait l’assemblée de l’après-midi. C’est à une heure trente que le message parvint : les indépendants s’étaient décidés, après des heures d’hésitations, à nommer trois « commissaires du peuple » au Cabinet d’Ebert [3]. Leurs conditions étaient dures. Hier encore, Ebert ne les aurait pas acceptées. Il n’y jeta qu’un coup d’œil : pouvoir politique aux conseils d’ouvriers et de soldats ; report de la décision concernant la convocation d’une Assemblée nationale ; pouvoirs égaux pour chacun des « commissaires du peuple ». Tout allait s’arranger. L’essentiel était que les indépendants soient au gouvernement. Leur liste était d’ailleurs rassurante : Haase, leur président, un mou mélancolique habitué à toujours se plaindre mais à toujours céder ; Dittmann, un zéro ; le troisième, Emil Barth, était un des dirigeants des Délégués révolutionnaires : pas une mauvaise idée, de l’avoir comme otage dans le gouvernement. Ebert accepta conditions et hommes, sans objection ni discussion. Tandis qu’il déjeunait en hâte et écrivait son discours, il se sentit remis en selle. Une troisième réunion importante eut lieu encore, en ce début d’après-midi, avant l’épreuve décisive du cirque Busch : celle des Délégués révolutionnaires, qui voulaient revoir leur tactique à la lumière des derniers événements. Contrairement à Ebert et à Haase, ils connaissaient déjà les résultats des élections du matin : ils avaient été témoins de leur déroulement et savaient que les résultats étaient mauvais pour leur cause. Il fallait qu’ils trouvent autre chose, et ils y parvinrent. Richard Müller raconte : « Les résultats du vote montraient clairement que les socialistes de droite et les indépendants de droite [...] avaient la majorité. Il n’était plus possible d’envisager un gouvernement sans les socialistes de droite. C’était un fait qu’on ne pouvait qu’accepter. Il était également clair que ces derniers s’efforceraient de briser le pouvoir des conseils d’ouvriers et de soldats pour parvenir à une Assemblée nationale et à une république démocratique bourgeoise. S’ils y parvenaient, la révolution était perdue. » Que faire ? Quelqu’un - impossible de savoir qui - eut l’idée salvatrice. Si l’on ne pouvait empêcher la constitution d’un gouvernement Ebert, il fallait élire un autre organisme à partir duquel pourrait se développer une sorte de contre-gouvernement. Après tout, les Délégués révolutionnaires étaient les organisateurs de l’assemblée de tout à l’heure, ils en auraient donc la présidence et seraient les maîtres de son ordre du jour. En manœuvrant habilement, il devait être possible de donner naissance non seulement au « Conseil des commissaires du peuple » mais à un autre conseil où siégeraient leurs hommes. Richard Müller encore : « Il fut décidé de proposer à l’assemblée un comité d’action des conseils d’ouvriers et de soldats. Il ne fallait surtout pas parler de ses fonctions. Il devait être créé sans débat, pour ainsi dire par un coup de bluff. » Ainsi étaient posées les mines et les contre-mines des adversaires. Et, à cinq heures, tandis que le crépuscule de novembre s’étendait sur Berlin et que les bourgeois rentraient de leur promenade au bois dans leurs maisons mal chauffées, la révolution et la république parlementaire bourgeoise entrèrent en lice dans l’arène du cirque Busch, où bouillonnait une foule de deux ou trois mille personnes. L’une et l’autre combattaient sous de fallacieuses couleurs : Ebert lui-même se disait révolutionnaire ; les révolutionnaires eux-mêmes se disaient parlementaires. Mais la victoire ou la défaite de chacun des deux camps était entre les mains d’une assemblée comme l’Allemagne n’en avait jamais connu et n’en a plus vécu jusqu’à ce jour : dans les rangées du bas, un millier d’hommes en uniforme formaient un bloc discipliné et déterminé ; au-dessus, et jusqu’à la coupole, mille ou deux mille ouvriers et ouvrières tendaient passionnément, dans la pénombre, leurs visages soucieux et amaigris. Sur la piste, une tribune improvisée, le bureau de l’assemblée, et tout le gratin des partis socialistes, d’Ebert à Liebknecht. Emil Barth, dirigeant des Délégués révolutionnaires et commissaire du peuple désigné par l’USPD, assurait la présidence. C’était un homme d’action énergique, mais aussi un vaniteux, qui se prenait pour le Napoléon de la révolution et s’écoutait un peu trop parler. Ce qui ne serait pas sans conséquence, ce soir-là, pour lui et pour sa cause. Ebert, qui parla en premier, annonça l’unité des deux partis socialistes et eut tout de suite l’assemblée pour lui : c’était cela qu’elle voulait s’entendre dire. D’ailleurs son discours - paternel, solide et pondéré comme toujours - correspondait bien à l’état d’esprit ambiant. Il parla beaucoup de calme et d’ordre, un ordre nécessaire à « la victoire définitive de la révolution ». Le discours de Haase, le dirigeant des indépendants, qui suivit, parut terne par comparaison. Il ne pouvait que confirmer ce qu’Ebert avait dit ; et peut-être pouvait-on déceler qu’au fond il était contre la coalition. Le sort de Haase a toujours été de présenter au public des décisions du parti qui avaient été adoptées contre son avis. Cela avait déjà été le cas le 4 août 1914. Ensuite vint le tour de Liebknecht, qui tenta de remonter le courant. Il énuméra tout ce que l’on pouvait reprocher au SPD et à sa politique du temps de guerre. Mais c’était justement ce que personne ne voulait entendre en ce jour de réconciliation et de victoire. II fut souvent interrompu, surtout par les soldats des premiers rangs qui commencèrent à s’agiter et à crier en chœur : Unité, unité ! Il fallait à présent voter. Le moment était venu de faire adopter, comme une affaire secondaire et allant de soi, le comité d’action, pour lequel le bureau de la réunion, c’est-à-dire les Délégués révolutionnaires, avait une liste de candidats toute prête. C’est là qu’Emil Barth commit sa grande faute. Au lieu d’appeler au vote, et contrairement à ce qui avait été convenu, il se lança dans un quatrième discours, fort long, que ce soit pour réparer l’échec de Liebknecht ou pour le plaisir de s’entendre. Son ami-ennemi Richard Müller qui, impuissant, se tortillait sur sa chaise à côté de lui, note : « L’auditeur attentif pouvait percevoir l’intention véritable qui se cachait derrière les paroles de Barth. » C’est surtout Ebert qui la perçut. Il redemanda la parole et déclara brièvement et fermement qu’un tel comité était « superflu » mais que, s’il devait être constitué, il fallait qu’il soit, tout comme le gouvernement, formé paritairement de membres des deux partis ; or, dans la liste qu’il venait d’entendre, il n’avait relevé aucun nom SPD. Sur quoi Barth gâcha définitivement l’affaire en s’écriant furieux que, dans ce comité, il était hors de question de voir siéger des socialistes de droite ! C’était mettre le feu aux poudres. « Ce qui s’ensuivit, écrit Richard Müller, dépasse toute description. Les soldats hurlaient à qui mieux mieux "Unité, parité !" Le capitaine von Beerfelde présenta une liste de soldats. Le socialiste de droite Büchel (que Barth, selon le récit de l’autre Müller, Hermann, essayait de réduire au silence en lui tapant dessus avec sa cloche de président) accourut à la tribune avec une liste pour son parti. Richard Müller et Karl Liebknecht essayèrent de s’exprimer contre la parité ; on couvrit leurs paroles par des cris. L’excitation devint fureur. Les soldats envahirent la piste et s’imposèrent à la tribune. Ils menaçaient de continuer la révolution tout seuls, sans les ouvriers et sans les partis, et d’instaurer un pouvoir militaire. Le tumulte était tel que la réunion dut s’interrompre. » Pendant cette pause, tandis que les soldats des premiers rangs tonnaient et que les ouvriers du haut échangeaient des regards inquiets et discutaient entre eux, on se mit à négocier fébrilement sur la piste, sous les yeux, mais hors de portée des oreilles de l’assistance, car cette époque ne connaissait pas les micros. Les deux camps avaient tout à coup pris peur, et lançaient des propositions irréfléchies. Un moment, le SPD fut prêt à se contenter de deux membres sur onze, à un autre moment les Délégués révolutionnaires voulurent renoncer tout à fait au comité, mais le SPD n’était plus d’accord : ça aurait l’air de quoi ! Bon, alors, un comité paritaire, mais il fallait décider tout de suite de sa composition. Quelqu’un proposa Liebknecht, mais celui-ci refusa : jamais il ne s’assiérait à la même table que les gens d’Ebert ! Quand on se fut enfin entendu, les soldats firent de nouvelles difficultés. Ils exigeaient maintenant une double parité : non seulement entre les deux partis mais entre ouvriers et soldats. Bien, il se faisait tard, il fallait en finir, et l’on accepta. Mais les soldats n’arrivèrent pas à s’entendre sur une liste de représentants. Enfin on rouvrit la séance et, tandis que le calme revenait lentement, Barth annonça la composition d’un « Conseil exécutif des conseils d’ouvriers et de soldats » : dix soldats et dix ouvriers, dont une moitié présentée par le SPD, l’autre moitié présentée par les Délégués révolutionnaires. Les soldats éliraient leurs représentants le lendemain. L’assemblée entérina. Elle en était au point d’accepter à peu près tout. Il était tard, l’heure du dîner était passée depuis longtemps, tout le monde avait faim (on avait faim alors, en Allemagne) et beaucoup avaient bien du chemin à faire pour rentrer chez eux. Soudain, tout se précipita. On confirma le nouveau gouvernement, qui s’appellerait désormais « Conseil des commissaires du peuple », et l’on adopta une résolution, préparée à l’avance, qui contenait beaucoup de mots ronflants sur la république socialiste et la révolution mondiale (elle fut publiée le lendemain par la presse bourgeoise, mais pas par le Vorwärts). Puis on chanta L’Internationale et enfin le cirque se vida. Il faisait nuit. Personne n’était content. Les Délégués savaient qu’ils avaient perdu la bataille. Ebert avait arraché, pour son gouvernement contre-révolutionnaire, une légitimation révolutionnaire ; et ce ne serait guère le Conseil exécutif, tel qu’il était composé, qui ferait grand-chose contre lui. Mais Ebert n’était pas plus satisfait : il avait gagné, c’est vrai, il avait gardé la main, mais à quel prix ! Les indépendants constituaient la moitié de son Cabinet, ce Conseil exécutif suspect formait une sorte de second gouvernement, lui-même n’était plus Chancelier du Reich mais « commissaire du peuple », il était placé contre son gré à la tête d’une révolution qu’il avait voulu intercepter et qui l’avait en quelque sorte annexé ! Les collègues du ministère et du Parlement, le haut commandement de Spa, allaient-ils lui garder leur confiance ? Il se sentait poussé malgré lui dans le rôle du fourbe. Il avait toujours haï la révolution, mais il la haïssait plus que jamais pour l’avoir forcé, lui homme sincère, à devenir un traître et un menteur. Car cela ne faisait aucun doute : s’il voulait encore que la révolution ne soit pas - et il ne pouvait rien vouloir d’autre, il lui faudrait la trahir. Il était condamné à jouer un double jeu. En serait-il capable ? L’État et la société qu’il voulait sauver seraient-ils disposés, après ce qui s’était passé, à se laisser sauver par lui ? Sur ce dernier point au moins, il fut partiellement rassuré le soir même par un coup de téléphone inattendu. Cet appel lui parvint sur la ligne secrète dont il ignorait jusque-là l’existence, et qui reliait le Commandement suprême à la Chancellerie. C’était Spa à l’appareil : le général Groener. Enfin un homme comme il faut, avec qui l’on pouvait parler ! La teneur de cette conversation, qui est entrée dans la légende, n’est pas connue. Elle n’eut aucun témoin. Mais, si Ebert n’en a jamais parlé par la suite, on peut s’en faire une idée par les déclarations ultérieures de Groener. Ce dernier offrit sa coopération loyale, et posa des exigences : lutte contre l’extrémisme et le bolchevisme, élimination aussi rapide que possible de cette « monstruosité » qu’étaient les conseils, convocation d’une Assemblée nationale, retour à « une situation d’ordre ». Ebert ne pouvait qu’approuver de tout son cœur. Il dut s’épancher sincèrement, car Groener nota plus tard qu’il avait tiré de cette conversation l’impression qu’Ebert « ne se maintenait qu’à grand-peine aux commandes et n’était pas loin d’être submergé par les indépendants et le groupe de Liebknecht ». Il devait encore être sous l’effet de la tumultueuse assemblée qu’il venait de quitter. Finalement Ebert remercia le général. Pas l’inverse, notons-le... Groener a parlé plus tard d’une « alliance » nouée en cette soirée. C’était un pacte de combat contre la révolution, alors que celle-ci venait de porter Ebert en triomphe. « Ebert accepta mon offre, écrit Groener. A partir de ce jour, nous avons eu, chaque soir, sur la ligne secrète, une conversation sur les mesures à prendre. L’alliance a tenu bon. »
[1] "Sous les tilleuls", avenue de
Berlin qui part de la porte de Brandebourg)
2][ ERZBERGER Matthias (1875-1921), principal négociateur allemand de l’armistice ; puis ministre des Finances assassiné par des nationalistes. [3] Des pourparlers entre les deux partis SD aboutissent (le 10, vers 13H30), à un texte qui stipule que le nouveau gouvernement « est formé exclusivement de social-démocrates, qui sont commissaires du peuple avec des droits égaux. [...] Le pouvoir politique est entre les mains des conseils d’ouvriers et de soldats, qui seront bientôt convoqués à une réunion représentant l’ensemble du Reich. La question de l’Assemblée constituante ne sera pas posée avant la consolidation de l’ordre actuellement établi par la révolution, et elle fera l’objet de discussions ultérieures ». (Broué, p. 157)
|