De la violence au terrorisme
[Le diable] était homicide dès le commencement et n’était pas établi dans la vérité parce qu’il n’y a pas de vérité en lui: quand il profère le mensonge il parle de son propre fonds parce qu’il est menteur et père du mensonge. [1]
Approche de définition du mensonge.
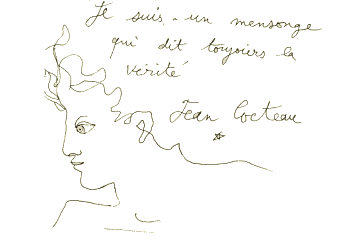 La violence a effectivement partie liée au mensonge. Nous l’avions vérifié en observant les pharisiens opposer à la Parole du Christ une imprécation de mort et n’arguer contre elle qu’un fallacieux blasphème auquel eux-mêmes ne durent pas croire longtemps. Mais ce que ce texte de Jean expose, tient au caractère inéluctable de la violence: non pas qu’elle fût, comme on l’a pensé, le fruit nécessaire de la méchanceté humaine, mais plutôt la seule forme possible que revêtent l’usurpation de pouvoir et l’expulsion du vrai.
La violence a effectivement partie liée au mensonge. Nous l’avions vérifié en observant les pharisiens opposer à la Parole du Christ une imprécation de mort et n’arguer contre elle qu’un fallacieux blasphème auquel eux-mêmes ne durent pas croire longtemps. Mais ce que ce texte de Jean expose, tient au caractère inéluctable de la violence: non pas qu’elle fût, comme on l’a pensé, le fruit nécessaire de la méchanceté humaine, mais plutôt la seule forme possible que revêtent l’usurpation de pouvoir et l’expulsion du vrai.
Ceci est une évidence: refuser Dieu, refuser d’entendre et d’accomplir ses volontés, implique pour le monde spirituel, la contre partie systématiques des préceptes divins. Devant l’amour, la haine; contre la Parole, le mensonge; devant la vie, la mort.
Nous entendrons donc par violence, le signe manifeste d’un refus, l’expression d’un intérêt; la forme du mensonge.
On pourrait en effet se contenter d’une définition minimale du mensonge. Dire le faux en sachant que c’est le faux. Dans un tel cas de figure, le mensonge s’assimile au mal tel que nous l’avions déjà envisagé: commettre le mal en sachant que c’est le mal. Le mensonge effectivement a partie liée au libre arbitre. Celui qui ment, d’abord, est celui qui le peut. Mais dans une telle acception qui n’est pas fausse en elle-même, mais assez peu féconde du point de vue théorique, le mensonge serait seulement un problème de connaissance et concernerait uniquement le rapport au vrai. Or ce que dit Jean est plus grave: le mensonge a partie liée à la violence et donc au réel. Dans notre langue, tout empreinte de latinité, nous avons omis ce que le grec avait pris soin de distinguer. Nous confondons trop le vrai et le réel. Dire c’est vrai signifie souvent c’est réel, cela existe. La vérité concerne le monde des idées, la théorie et le monde de la pensée. Le réel, quant à lui, concerne la chose, l’objet, ce qui se trouve, là, en face de nous, qui concerne la matière.
Ne pas confondre l’être et la pensée, voici ce à quoi nous invite d’abord Jean. Oui, le diable parle exactement comme Caïphe, de son propre fond. Le pharisien, qui coupe la relation, s’interpose entre les locuteurs et parasite la communication: il exerce ainsi une violence, un meurtre. Celui-ci est peut-être logiciel dans un premier temps, mais bien vite, matériel; la Passion l’illustre. On ne peut donc sans artifice isoler la question du mensonge de celle de la violence. J’appelle mensonge, la violence logicielle.
Or, nous cherchons justement les formes de la faute, condition préalable d’une théorie du mal.
Vouloir expliquer la violence par la seule malignité humaine est un peu court, puisque ceci nous obligerait à expliquer préalablement les conditions de possibilité de cette méchanceté. C’est bien sur cette question qu’achoppèrent toutes les théologies, toutes les théodicées, toutes les morales chrétiennes.
Comment se fait-il que l’homme soit méchant? Comment répondre autrement que par le libre arbitre? Mais, ce faisant, on ne fait que poser les conditions de possibilité de la faute, et non sa cause. Effectivement l’homme n’aurait su produire le mal si son essence avait été entièrement déterminée vers le bien. Mais le libre arbitre humain ne résout rien en soi. Comment se fait-il que l’homme, quoiqu’il eût tout intérêt à se conformer aux préceptes de la loi, s’en écartât néanmoins? Pourquoi fit-il le mauvais choix quand il aurait parfaitement pu opérer le bon? Dire: parce qu’il est méchant revient à baptiser la difficulté plutôt qu’à la résoudre. Effectivement l’homme ne peut être méchant; tout au plus le devient-il. Car s’il est méchant, cela signifie que Dieu l’ait conçu tel, ce qui est manifestement absurde.
Non il faut manifestement revenir aux faits. Partir de la réalité et chercher les formes revêtues par la faute. Pour deux raisons:
parce que c’est la seule manière de résolument produire une théorie de la violence, dont nous avons urgemment besoin.
parce que l’idée de sagesse telle que nous l’avons posée ci-dessus nous incline à relier systématiquement théorie et pratique.
La violence est la forme concrète que prend le mal et par violence j’entendrai donc désormais le signe manifeste ( ou manifesté) du refus; la forme avérée du mensonge; l’expression même de l’intérêt au détriment du service.
Le terrorisme est le stade suprême de cette violence-ci; l’argument majeur, massu, que l’on oppose à la parole et à l’acte de l’autre quand ce dernier gêne. Insuffler en l’autre une peur telle qu’il finisse par disparaître ou céder devant soi, puisque, oui, la menace de mort est l’armument suprême, imbécile mais terriblement efficace dont notre histoire demeure hantée.
Mais la terreur est un sigle aussi. Souvenons-nous de 1789. Une révolution s’engage qui se voulait entreprise de libération nationale contre les tyrans. Elle ensemença la réconciliation nationale sous l’égide de la liberté et de l’égalité entre les hommes - riches idéaux après lesquels notre nostalgie court toujours - et en apothéose de cette fraternité, la fête de la Fédération de 1790 se conserve en notre mémoire comme un souvenir peut-être terni mais ému cependant. Pourtant, l’intention louable rencontra obstacles et ennemis. Alors la générosité un peu trop candide des Siéyès ou des Mirabeau s’épuisa dans la morgue de Robespierre: la Terreur!
De combien d’idées généreuses, pas toujours fausses du reste, en alla-t-il ainsi, qui se condamnèrent elles-mêmes dans l’horreur persécutrice? Depuis 1789, combien de théories humanistes, combien de projets libérateurs, combien d’explications scientifiques dont la découverte avait légitimement suscité de réels enthousiasmes et ouvert de fabuleuses perspectives, mais dont l’exécution et la mise en pratique signifièrent en réalité la mort? Pour un Rousseau, combien de Robespierre? pour un Marx, combien de Staline? pour un Nietzsche, combien d’Hitler?
Le pire réside peut-être en ceci: il revêt souvent de douces apparences. Vérité, que de crimes commet-on en ton nom!
Mais l’horreur se cache. Où la métaphore du théâtre reprend du service puisque nous nous travestissons. L’hypocrite est bien étymologiquement un acteur qui se camoufle et la pensée une affaire de représentation.[2] La terreur est fantastique parce qu’on ne la voit jamais poindre: de la même façon que la littérature fantastique s’ingénie, à partir d’une situation tout à fait normale pour laisser insensiblement éclore l’étrange qui grandira au point de finalement phagocyter l’espace; la terreur elle aussi se travestit dans un premier temps sous la forme d’idéaux désirables. Mais il est toujours trop tard quand enfin on la reconnaît.
Mais encore: pour une horreur, combien de serviteurs fidèles, naïfs ou tranquilles? combien de complices inconscients? Pour un Hitler, combien de petits bourgeois, de petits employés savourant Mozart le samedi soir, mais qui finirent pourtant en fidèles exécutants du génocide, en organisateurs efficaces et consciencieux d’une ignominie jusqu’alors insoupçonnable? [3] Sous l’impavide tranquillité du quotidien, combien de bourreaux, ressemblant à s’y méprendre à la victime?
C’est ceci que nous avons sans doute le plus de difficultés à endurer: passe encore que le mal se présente devant nous sous le masque hideux de l’épouvante! Mais comment soutenir l’horreur quand elle revêt les allures de la banalité la plus anodine? sous la forme de la faiblesse? Le monstre n’est jamais l’autre: il peut être nous, à chaque moment! L’impression sourde alors que nous soyons à nous-mêmes notre plus grand danger! Le mal, ce n’est jamais seulement l’autre, mais nous, potentiellement. Le mal n’a pas de signes extérieurs de reconnaissance: il n’y a pas de caractériologie possible du mal; ni de morphologie du méchant, non plus que de gène du criminel! Ce serait trop facile. Le montre, c’est lui, moi, nous tous demain, presque toujours. Virtuellement [4]
Dans son étonnante efficacité technique, notre siècle aura fignolé toutes les réponses terroristes: suave, dans la psychiatrie; brutale et guerrière dans la soldatesque; rusée ou résignée dans la politique. Tel est l’état des lieux. Nous savons désormais que la violence n’est pas que de mort physique; mais aussi orale. Nous en maîtrisons tous les cadres car elle est devenue la logique de notre civilisation.
Il est impossible que nous n’en disions mot. De ces horreurs, notre siècle chercha à se disculper en en éloignant la responsabilité sur quelques têtes, cachant à merveille l’océan de nos complicités. «C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Rousseau» chantait ironiquement Gavroche. C’est la faute à Hitler! Non justement! Soyons plus honnêtes.
Il n’est pas de maître efficace sans serviteurs fidèles. Notre siècle aura peaufiné toutes les réponses terroristes parce que la technique moderne en son étonnant développement l’a rendu possible. Nos pouvoirs excèdent désormais largement notre sagesse.
«La science a fait des hommes des dieux longtemps avant qu’ils ne devinssent des hommes»[5]
Cette formule est intéressante à plus d’un titre.
D’abord parce qu’elle rejoint celle par laquelle nous avions inauguré notre réflexion. Nous avions effectivement envisagé cette figure curieuse de l’humain où les coubes de la sagesse et de la puissance ne se rejoignent jamais vraiment, ou que de manière si fugace. Nous avons déjà tiré ici ce que serait la figure absolue du mal: quand les courbes sont éloignées au maximum.
Ensuite parce qu’elle souligne que la volonté de puissance de l’homme peut parfaitement s’exprimer sous la forme de la révolte contre Dieu; nous démontrerons qu’il ne s’agit pas que d’une métaphore.
****
La crise
L 'homme vit en société. Aristote le concevait comme un "animal politique". Pour lui la sociabilité était inscrite dans la nature humaine; au contraire Rousseau estimait que l'homme, enclin dans l'état de nature à éviter la souffrance, était spontanément poussé à fuir ses congénères plutôt qu'à s'allier à eux. Selon lui, si l'homme finalement se lie aux autres, c'est par contrat social, volontairement. Qui a raison? Il n'est pas certain que le problème soit d'importance; il mérite pourtant d 'être posé.
Ce qui est certain, néanmoins, est que la socialité fut l'occasion pour l'humain de se révéler. Ce qu'il y a de spécifiquement humain dans l'homme, où l'on peut reconnaître son origine spirituelle aussi bien que son intelligence ne semble effectivement pouvoir se développer et s'exprimer que dans la communauté.
Avant d'être métaphysique, c'est une question pratique. L'homme isolé dans la nature est trop meurtri par les rudes conditions de sa survie pour pouvoir s'occuper d'autres choses que de se nourrir, se reposer et se reproduire. Quand l'exercice des fonctions vitales exige toute l'énergie et le temps de l'homme, alors son humanité cède le pas devant l'animalité. Toutes les philosophies sont d'accord là-dessus: que la nature humaine ne soit qu'un produit de l'histoire ou qu'elle soit le fruit d'une création divine, elle ne peut en tout cas s'exprimer, se réaliser et poser sa marque sur le monde qu'à la condition d'avoir préalablement rendu les conditions de sa survie matérielle moins contraignantes.
Or, la seule solution pour y parvenir, est la société, la division sociale du travail qui, par une efficacité accrue et calculée du labeur, dégage des plages de temps libre, des possibilités nouvelles, des stocks.
"Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui lui manquait auparavant. C'est alors seulement que, la voix du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui, jusque-là, n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d 'agir sur d 'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grands, ses facultés s 'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que, si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qui l'en arracha à jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme.[6]
On discutera sans fin pour savoir si l'homme est naturellement social ou s'il y entra volontairement par intérêt tactique. Le résultat est le même, que tous les philosophes reconnaissent: l'homme ne peut donner sa pleine mesure que dans la communauté sociale.
La fiction de l'état de nature illustre, derrière la raison du plus fort qui y domine, combien l'homme est d'abord compressé par le milieu environnant comme par les autres hommes. La liberté dont il y dispose est sans doute infinie mais jamais accomplie parce qu'il est trop enfermé dans les déterminismes naturels. instincts et violence s'appuient uniquement sur le fait du plus fort; autant dire que la morale naturelle ne se fonde que sur le rapport de force et qu'en conséquence elle ne bénéficie d 'aucune stabilité, d'aucune légitimité. L'homme y est contraint par les pressions immédiates; autant dire qu'il y est incapable d 'aucune réflexion, d'aucune prévision. Oui, c 'est bien à la fois la moralité, l'intelligence et le projet qui deviennent possibles grâce à la société qui offre à l'homme la possibilité d 'un répit, la grâce d'un recul.
Que l'on se situe dans une perspective athée ou spirituelle ne change d'ailleurs rien au problème. Que l'homme naisse dans le rapport à l'autre, ou qu'au contraire il y puisse seulement révéler, réveiller son essence spirituelle paralysée dans une matière trop frustre encore; dans tous les cas on observera que le développement humain est conditionné par la communauté, par le regard de l'autre. L 'homme ne devient homme que sous le regard des autres hommes.
C'est assez avouer que la question politique n'est pas une question subsidiaire qui viendrait à se poser après que tous les problèmes spirituels et moraux eurent été résolus; mais qu'au contraire la politique est la forme même que doit revêtir la moralité accomplie. Pour autant que l'on doive à Machiavel, la théorie d'une séparation radicale entre morale et politique, on considérera que le signe de la faute réside ici.
Rousseau avait, quant à lui, parfaitement compris que la moralité humaine était tout entière suspendue autour de la bonne organisation de la sphère sociale. Lorsqu'il énonce que:
"L'homme est naturellement bon; c'est la société qui le corrompt"
cela signifie non pas que l'homme soit effectivement bon, mais qu'il a la puissance de le devenir à condition que la structure sociale ne l'en empêche pas. Toute une tradition philosophique, du siècle des Lumières au positivisme scientiste du XlXe, en passant par Marx, fit ainsi de la rénovation sociale la condition de possibilité de l'avènement, de l'épanouissement humain. Certes, on peut considérer qu'elle intervertissait ainsi l'ordre des priorités, qu'il eût mieux valu changer d'abord l'homme avant la société -ce qui est exact- mais elle considéra qu'aucune élection n'était réellement possible dans le cadre d'une société injuste, pervertie et violente -ce qui n'était pas nécessairement faux non plus! Pour Rousseau comme pour Marx, une société de privilèges, d'inégalité ne pouvait que contraindre les citoyens à des comportements violents et immoraux. Leur logique était institutionnelle. Elle aboutit peut-être au désastre que l'on sait, mais faut-il pour autant s'interdire de repenser ce cheminement?
Ce que tous les philosophes politiques avaient perçu, tenait à la centralité de la violence. Et en ceci ils n'avaient pas tort. Car, à l'instar des traditions spirituelles, les philosophes politiques avaient fait de l'interdiction de la violence l'ossature de tout système politique.
Du "Tu ne tueras point" au Contrat social qui, précisément consiste dans le renoncement au droit de vengeance et de poursuite, la question spirituelle et politique partent des mêmes bases, ont la même source d'inspiration.
Nous tenterons plus bas de donner une théorie de la violence. Il faut préalablement envisager la manière dont l'histoire humaine s'efforça de résoudre les problèmes qu'elle posait.
A nouveau, morale et politique se rejoignent ici. La loi dans les deux cas se veut l'antidote de la violence.
Des hommes se rassemblent en communauté et la nécessité naît immédiatement d'une organisation. Le pouvoir et la loi se déduisent logiquement de la socialité. Il n'y a pas de société sans loi; il n'est pas de loi sans un pouvoir qui la fasse respecter.
[Première question: comment et par qui seront définies les lois ?
Nos sociétés modernes se veulent état de droit, où la loi sociale, écrite, domine en filiation d'avec la tradition romaine. Nous avons poussé jusqu'au paroxysme, la puissance de la loi.
L'étymologie l'annonce: la loi (nomia) indique la norme des comportements humains que la communauté peut tolérer sans se déchirer. La loi est de partage: l'interdit d'un côté; le souhaitable de l'autre. On le comprend bien. morale et politique se rejoignent au plus près car la politique est la morale de la collectivité. Tout au plus remarquera-t-on que la loi définit plutôt ce qui est interdit; en supposant permis en tout cas tolérable ce qu'elle tait, ce qui n'est pas prohibé. La loi sociale pose le mal. Le bien s'en déduit implicitement.!
[Deuxième pierre d'achoppement: comment se fait-il que nous ne puissions définir le mal à partir du bien, mais seulement l'inverse. Comment logiquement interdire si l'on est seulement incapable de penser le bien ? Comment expliquer cette incapacité historique à saisir positivement la loi.?
Les grecs étaient assurément plus fins qui distinguèrent deux sortes de lois selon que leur origine fut humaine ou divine. La loi écrite et la tradition orale; le droit positif et le droit naturel; la "norme" d'un côté; la thesmos de l'autre où l'on reconnaît le radical theos (Dieu). Relèvent de la thesmos ces lois dont l'origine se perd dans la nuit des temps et dont on peut assurément présumer qu'elles furent prescrites par les dieux et répétées de toute éternité par la coutume, la tradition orale.
C'est d'ailleurs en ceci que l'on reconnaîtra l'origine de la tradition judaïque: les lois divines n'y sont pas orales, mais bel et bien écrites lors de cet étonnant dialogue entre Dieu et son prophète. L'acte même de l'Alliance est un acte juridique; l'alliance est même un acte fondateur, constitutionnel. L 'alliance qui fonde le contrat, s'exprime juridiquement sous la forme du Décalogue.
La loi indique le comportement qu'il faut suivre, la normalité à laquelle chacun doit se plier faute de remettre en question la stabilité de toute la collectivité. Qu'ils soient ou non explicites, les interdits sont intimement liés à l'idée de loi, qui définissent ainsi, en creux certes, mais assez clairement néanmoins, ce que chaque société redoute, ce à quoi elle aspire.
Or, des sociétés les plus primitives aux cultures les plus modernes, il parait bien à tous les anthropologues que l'interdit de l'inceste soit universel quoique les frontières de ce dernier se définissent parfois différemment.
Il peut paraître surprenant que l'interdit fondateur soit celui de l'inceste. On attendrait précisément plutôt celui de la violence. Pourtant, parce que celui-ci touche à la sexualité, et donc à la capacité même de reproduction de l'espèce humaine, on peut effectivement considérer que cet interdit comporte une dimension réellement métaphysique.
Derrière l'interdit se joue en réalité l'essence même de la crise sociale.
Nous avons trop tendance à interpréter le terme de crise au sens de catastrophe ou de défaillance quand en réalité son étymologie signifie plutôt l'état de passage d'un équilibre à un autre. La crise est une tension certes mais surtout une transition, une mutation. La crise n'est jamais finale; elle est toujours transactionnelle.
Il faut donc tenter de comprendre ce que cache cet interdit de l'inceste.
Premièrement on n 'interdit jamais que ce qui effectivement se pratique. Si l'interdit de l'inceste figure dans chaque particularisme culturel, c'est qu'il se pratiqua, à un moment ou à un autre. En l'interdisant, les législateurs voulurent assurément donner une nouvelle dimension à leur société. Laquelle ?
Deuxièmement, il n 'est pas certain que cet interdit soit fondateur, il est peut-être simplement le seul dont nous ayons trace assurée de façon universelle. On ne pourra le considérer comme essentiel que pour autant qu'il nous aura révélé le rapport qu'il entretient avec la question métaphysique de la violence. A tout le moins peut-on le considérer comme le plus ancien de nos interdits et ceci déjà est significatif.
D'abord l'inceste est une pratique sexuelle exercée au sein d'un même groupe, d'une même famille, d'une même tribu. Il serait sot d'imaginer que les primitifs sussent ce que la génétique moderne vient seulement de comprendre. Les risques génétiques qu'implique l'inceste étaient ignorés. Mais ce dont on peut en revanche présumer c'est l'implication de l'exogamie. Aller rechercher une épouse à l'extérieur de son groupe, de sa famille, de sa tribu, c'est vouloir entretenir un rapport suffisamment fort avec le monde, c'est vouloir rechercher des alliances suffisamment solides pour que sa survie ne soit plus menacée par la cohorte d'ennemis supérieurs en nombre. Derrière l'inceste se joue effectivement une transaction, une alliance au sens le plus concret du terme. Lévi-Strauss le comprit en observant les tribus amazoniennes. Celui qui épouse sa soeur n 'a pas de beau-frère avec qui chasser; celui qui épouse une autre femme aura, quant à lui, deux beaux-frères. La référence est sans doute économique; elle est peut-être triviale mais elle est éclairante. L 'interdit de l'inceste participe effectivement du problème de la survie de l'humanité. Elle est la première forme d'évitement non pas de la violence, mais en tout cas de ses conséquences les plus funestes.
Ensuite, l'inceste est une pratique commune dans le monde animal. Il n'est pas impossible que l'interdit de l'inceste participe de cette conscience lentement acquise de l'humanité dans l'homme; de la volonté de se distinguer du monde animal en conférant une moralité à l'acte même de reproduction de l'espèce. Il n'est qu'à regarder combien est répété dans les textes de l'Ancien Testament l'interdit de la zoophilie. Ici encore, la même remarque. Si l'on prend le soin de préciser l'ignominie du commerce charnel avec les animaux c'est que celle-ci se pratiquait. Or que peut bien signifier l'acte sexuel avec un animal si ce n'est que la conscience n'est pas encore affermie ou même seulement acquise de la différence de nature entre l'homme et l'animal. La zoophilie est perçue comme un acte pervers parce que nous semble insupportable l'idée d 'un partenaire de nature inférieure. A contrario, le zoophile ne perçoit-il pas l'animal ni comme différent, ni comme inférieur. C'est lentement, vraisemblablement, que l'humanité acquit le sentiment de sa différence et de sa dignité. Et effectivement, l'interdit de la zoophilie se répète de moins en moins au fil des textes sacrés au point de quasiment disparaître. C 'est alors que l'interdit devient évident.
Il en va de même pour l'interdit de l'inceste: il marque la volonté dès lors consciente de se distinguer de l'animalité et d'affirmer l'excellence de l'humain.
Mais l'interdit de l'inceste dit autre chose qui nous semble plus essentiel encore. Le refus du même, de l'identique.
Rien n'est effectivement plus dangereux dans une société que l'arasement des différences. A y regarder de plus près,
la violence naît non pas de la différence mais de la ressemblance. Si tous se ressemblent, dans leur apparence comme dans leurs désirs, alors inévitablement ils se heurteront les uns aux autres.
Pourquoi donc, par exemple, la guerre civile est-elle perçue, fort justement, comme l'horreur suprême?
L 'identique produit l'opposition, puis la lutte pour la conquête des mêmes objets, la mort enfin. C'est un fait social simple à comprendre; mais c 'est aussi une loi physique -l'entropie, deuxième loi de la thermodynamique définissant la tendance à la désorganisation de tout système; c'est une loi spirituelle enfin.
Ce que la physique a démontré est que toute dynamique naît d 'un différentiel de chaleur entre les pôles. Que ce différentiel vienne à s'annuler, ce qui est le terme prévisible de tout système clos, alors il s'effondre. Le vivant même l'illustre qui ne le reste qu'autant qu'il peut organiser une différence thermique entre lui et le milieu extérieur. Définir la vie comme l'ensemble des processus qui luttent contre la mort n'est pas erroné. L'entropie produit une différenciation de plus en plus ardue, bientôt impossible. On remarquera précisément que la mort physique se solde par une indifférenciation achevée entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. La reproduction par sexualité enfin en offre une autre illustration qui garantit la production d'individus absolument différents; qui fait toujours se payer l'endogamie de tares génétiques aggravés.
Faut-il s 'étonner dès lors que tous les interdits sur lesquels s'élabore la collectivité participent de cette méfiance à l'encontre de l'indifférencié et de ce qui le produit: le mimétisme ?
Tous nos mythes, toutes nos tragédies (Oedipus Rex de Sophocle par exemple), toutes nos philosophies, toute notre histoire enfin, racontent cette défiance à l'encontre de l'imitation. C 'est elle ainsi qui présidera au rejet des poètes hors de la cité idéale de Platon.
"en fait de poésie, il ne faut admettre dans la cité que les hymnes en l'honneur des dieux et les éloges de gens de bien. Si au contraire, tu admets la Muse voluptueuse, le plaisir et la douleur seront les rois de la Cité à la place de la loi et de ce principe que, d 'un commun accord, on a toujours regardé comme le meilleur, la raison.[7]
Effectivement, si l'imitation est parfaite, nous obtenons des doubles qui inévitablement s'opposeront. Ainsi les jumeaux sont-ils omniprésents dans nos mythes: Romulus et Rémus; Caïn et Abel. Mais aussi la peur des doubles, du miroir, des photographies dans les sociétés primitives. L 'identité parfaite apparaît comme le plus grand danger pour ce qu'elle débouche invariablement sur un conflit généralisé.
Analysons ainsi le mythe de la fondation de Rome: deux jumeaux aux origines incertaines. Parce que Rome veut se fonder sur une volonté divine dont elle escompte tirer une légitimité et une puissance infinie, elle ne peut se donner une origine trop précise. Toujours les mythes procèdent ainsi. De la même façon que la thesmos renvoie à l'ordonnancement si ancien que sans doute il fut prescrit par les dieux; de la même manière l'origine secrète des jumeaux rend-elle crédible la filiation divine. (On remarquera aussi l'origine confuse, ambiguë de Moïse: celui qui a un destin exceptionnel ne peut surgir d 'une source trop repérable). L'acte par lequel Romulus fonde Rome est le traçage d 'un sillon. Ce dernier représente la loi car il n 'est effectivement pas de société sans loi. Mais Rémus immédiatement franchit le sillon et meurt sous le glaive de son frère. Pourquoi franchit-il le sillon? On peut bien entendu penser à un conflit d'intérêt: ils veulent tous les deux le pouvoir, qui lui ne se partage pas. C 'est possible; ce n'est pas le plus important. Ce qui est clair ici, est que l'histoire romaine ne put débuter qu'une fois le double exclu. ils désirent la même chose; ils se ressemblent; ils s 'entre-tuent. Il faut aller plus loin encore. La loi n 'apparaît dans sa tangible réalité que pour autant qu'elle fût enfreinte. En franchissant le sillon, Rémus lui donne une réalité objective qui lui manquait auparavant de telle sorte qu'il n'est pas complètement faux d'estimer qu'il fut en réalité le premier roi de Rome.
Tant qu'ils étaient vivants tous les deux, c'était leur opposition qui dominait, leur ressemblance, et rien ne pouvait s 'ériger hors de ce mimétisme stérile. Il en va en politique comme en logique. Le tiers doit être exclu. Sinon tout devient confus. Entre le vrai et le faux, il n'y a pas, il ne doit pas y avoir de tierce solution. Entre l'homme et le monde, rien ne peut s'interposer sans quoi tout s'effondre. Rémus, le double est en réalité cette tierce solution. Il n'est fécond qu'en disparaissant.
L 'aspect le plus intéressant du mythe est de révéler comment justement la lutte contre l'imitation se réalisera par l'imitation elle-même.
Il est vrai que la mimesis est le principal mode d'acquisition accessible à l'homme: qu'il veuille savoir, il lui faudra apprendre et donc imiter la connaissance des anciens; qu'il veuille être sage, il lui faudra observer et donc imiter les préceptes moraux; qu'il veuille être bon citoyen, il devra respecter et donc imiter les comportements prescrits par les lois:
"C'est le puissant développement et l'usage intensif de la fonction de simulation qui me paraissent caractériser les propriétés uniques du cerveau de l'homme. Cela au niveau le plus profond des fonctions cognitives, celui sur quoi le langage repose et qu'il n'explicite qu'en partie. "[8]
Il ne saurait être étonnant que, même perçu sous son aspect psychologique, l'analyse de l'interdit de l'inceste par S Freud, offrît des conclusions sensiblement analogues.
On sait que la psychanalyse révolutionna la psychologie par l'hypothèse de l'inconscient. Ce qui nous intéresse ici est que Freud posât le fonds nécessairement agressif de la réalité humaine sans pour autant le considérer comme une fatalité. Oui! l'homme est naturellement désirant. Oui! ce désir ne peut se réaliser que par une visée du réel, autrement dit par un effort de réduction de tout écart entre le sujet et l'objet du désir. Certes, cette réduction ne va pas sans violence: manger, c'est assimiler; rendre semblable à soi. Il en va ainsi de tout désir.
Mais, non.' cette réduction n'est pas nécessairement violente, en tout cas ne l'est-elle pas de façon irréversible. Sans conteste, l'enfant découvre dès la naissance combien le monde lui est extérieur, étranger; il n'aura d'autre alternative que de nier à son tour ce monde qui le nie. D 'où les multiples phases du non. Mais cette négation du monde peut tout aussi bien passer par la sublimation, dont l'apprentissage fait l'objet quasi-exclusif de toute éducation. Construire un monument, écrire un roman, semer la terre, composer une ode, tout ceci atteste de la volonté humaine de ne pas se laisser corroder par le monde, de se distinguer de lui, d'en prendre le dessus.
Mais cette domination, culturelle et spirituelle, n'est pas essentiellement agressive. Ici la violence, la négation, a été investie sur des objets culturellement valorisés. C'est en ceci que consiste la sublimation. Freud révèle ici un mode, non de résolution de la violence mais en tout cas de canalisation de son expression individuelle. Il nous donne le secret de l'être: il n'est d'individu que par affirmation de sa différence. La conscience n'est possible que pour autant que l'on sache se distinguer du monde qui vous entoure, des autres aussi qui vous environnent.
D'où le tabou de l'inceste. Le complexe d'Œdipe n'a pas d'autre signification, selon Freud, que d'apprendre à l'enfant comment investir son énergie, ses désirs, sur des objets extérieurs à lui. Il vient de la mère, la conscience foetale est d'autant plus confuse qu'alors il n'est pas de différence -ou si peu- entre lui et la mère dont il parasite l'organisme. Qu'il puisse véritablement assouvir son désir incestueux, et donc retrouver, ne fût-ce que de façon fantasmatique cet état de plénitude prénatal où aucun désir ne pouvait éclore parce qu'il était toujours déjà satisfait, et c'en serait fini de sa vie!
Freud a ainsi parfaitement compris la fragilité de l'être et son paradoxe: l'homme n'existe qu'en écart aux autres, un écart que par ailleurs il cherche à combler sans devoir y parvenir jamais. Ce que l'on nomme plaisir. Freud a parfaitement saisi combien l'homme était coincé dans un dilemme fabuleux:
ou bien le désir est insatisfait et alors c'est bien de la volonté de le réaliser que se nourrit la dynamique vitale. Mais une insatisfaction totale nierait à terme l'être.
ou bien le désir se réalise totalement dans le plaisir mais l'énergie vitale s'effondre en une mortelle statique.
En clair, ou frustré, ou mort!
Il importe en réalité à l'individu de trouver le juste milieu entre un désir trop vite satisfait qui le laisserait démuni, hébété ou mort, et un désir sans cesse barré qui le frustrerait jusqu'à la folie ou l'impuissance.
Trouver le juste milieu entre la réduction absolue dans l'autre et la réduction totale de l'autre; trouver le point nodal où le plaisir serait assez fort pour stimuler la démarche vitale mais jamais assez complet pour éviter que ne sombre l'individu ni ne se complaise dans l'hébétude de l'orgasme; voici la tâche de chacun, tâche presque impossible, difficile en tout cas que la psychanalyse destine à l'humain.
La frustration est nécessaire quand elle n'emplit pas tout l'horizon humain parce qu'elle engage l'homme à se battre, à conquérir le monde, à lutter pour devenir. Etre frustré, mais pas trop, semble être la leçon de la psychanalyse. Elle est dure mais essentielle car elle nous fait comprendre qu'il serait naïf et sot d'espérer jamais un monde où la lutte, la souffrance seraient totalement bannies; car elle nous fait comprendre que la violence est un mal nécessaire à la réalisation de l'humain dans l'homme. Mais c'est en même temps en ceci que la théorie de la sublimation revêt toute son importance: cette violence n'est pas nécessairement destructrice, ou tout du moins ne le reste que dans les formes archaïques ou infantiles de notre développement psychologique. La tâche de l'humain est de faire advenir la conscience où prédominait l'inconscient; elle tient surtout dans cette démarche culturelle qui doit pousser l'humanité à s'inventer des formes nouvelles d'affirmation de son identité, des formes qui ne soient ni agressives, ni destructrices, mais enfin culturelles et fécondes.
A ce titre on peut effectivement considérer que pour Freud, comme pour la thermodynamique, le pire, ce qui engendre la violence a l'état pur, relève de l'indifférenciation. Que par là-même il nous permette de désigner le désir comme notre plus grand ennemi en cela que son aboutissement provoque nécessairement l'assimilation, la réduction de l'autre, l'indifférenciation, ne fait qu'illustrer ce que nous avons déjà à maintes fois relevé: nous sommes notre plus grand danger. Que Freud ait vu dans les processus de conscience, dans les processus désirants l'un des lieux de cette indifférenciation nous indique seulement qu'il ne suffira pas d'offrir une théorie politique du mal; qu'il nous faudra repérer dans notre propre structure mentale, les mécanismes de la faute.
En tout état de cause, la définition de la crise est à présent suffisante: il y a passage d 'un état à un autre à chaque fois que l'indifférenciation se fait reine. Qu'elle domine définitivement et c 'est la mort; qu'elle déplace les bornes de la différence, et c 'est une nouvelle structure sociale à l'avènement de quoi l'on assiste.
Nous avons vu que le pharisaïsme avait partie liée avec le mensonge et la violence; que la violence se fondait sur la mimésis. Ce qu'il faut à présent détailler.
La rivalité mimétique
Nul n'est besoin de chercher ici des exemples complexes. Deux hommes, face-à-face, désirent la même terre, la même poterie ou la même femme. Car c'est dans les comportements d'appropriation que la mimesis fait peser ses plus lourdes conséquences. L 'un des deux devra bien céder, de gré ou de force. Dans le premier cas, il renonce; dans le second, il se bat.
Qu'un individu tende la main vers un objet, l'autre immédiatement sera tenté de l'imiter, par curiosité ou par envie. Si l'imitation ne concernait que deux individus, la lutte serait limitée; mais on peut parfaitement imaginer que ce mimétisme gagne toute la collectivité (il ne faut d'ailleurs pas un grand effort d'imagination; il suffit de regarder autour de soi!). Alors on assiste à l'uniformité tragique des comportements, à la lutte de tous contre chacun, au déchirement de toute la communauté.
Ceci est presque une banalité: ce que les philosophes appellent état de guerre, à ce point dangereux que pour échapper à la dissolution complète, l'individu en soit contraint de passer contrat pour pouvoir survivre et transférer toute violence au profit de l'ordre social. Cet état de nature, "état de guerre de tous contre chacun"(Hobbes) est d 'autant plus pernicieux que la violence est infiniment renouvelable à l'instar des désirs humains; qu'aucun rapport de force n'est présumé stable puisque quelque soit la force d 'un seul, elle trouvera toujours une force supérieure, ne fût-ce que la réunion de tous les faibles.
L 'interdit, l'entrée en société sont donc des réponses à la crise mimétique: la réponse la plus sûre que l'homme ait trouvée jusqu'à présent.
Donc, on n'expliquera jamais rien en arguant seulement de la violence humaine; elle n'est pas une cause puisqu'elle est déjà un effet d'un processus plus profond, plus radical qui engage l'être en son entier, tant dans sa réalité physique, intellectuelle que psychologique. L 'homme n'est pas naturellement violent: il le devient quand il n'a pas d'autres solutions -ou le croit du moins- pour échapper à la mort.
Combattre ainsi la violence n'a pas beaucoup de sens; d'autant qu'on risque de ne pouvoir la combattre que par une violence plus grande encore. Car accepter la lutte, c'est tolérer la logique de la lutte; la logique de la violence, l'émulation.
Et c'est bien ce que nous devons ici constater: pour autant que la socialisation fut perçue comme un mode de résolution de la violence et que cette dernière néanmoins perdura, il faut bien conclure que la réponse était mauvaise, qui ne fit que déplacer le problème et non le résoudre.
Où l'on reconnaît ce qui est spécifiquement humain dans nos comportements: rien de ce que nous tentons n'est assuré d 'éternité ni seulement de pérennité. C 'est en ceci que nous sommes des êtres d'histoire. René Girard a parfaitement montré que la crise mimétique n'était jamais définitivement résolue. Comme un contrat que l'on renouvelle ou une promesse dont on célébrerait la conclusion, nos rites sont une manière habile parfois, nécessaire toujours, d 'échapper à l'éphémère. Que pointe à nouveau le danger et les hommes se souviennent de la valeur, de la puissance et de la nécessité de leur rassemblement. Notre fête nationale est un écho lointain du même processus: la célébration d'un ordre social d'autant plus fragile qu'il était plus dangereux et esquissé sur les désastres de l'ancien.
Le rite, la fête sont des représentations. L 'événement étant unique, parce qu'historique, on ne peut le rendre opératoire qu'en le rappelant incessamment à la mémoire. Regardez! Tout danger n'est pas écarté. Ne tenez jamais l'ordre pour un acquis définitif! L'entropie constamment menace. L'ordre est toujours à fortifier. C'est en ceci que la cérémonie publique se rapproche au mieux de ses origines religieuses; qu'elle s'affirme comme le contre-pied systématique du pharisaïsme pour qui l'ordre n'était que de conservation du pouvoir. Ici, le rappel des hommes sans qui rien ne tient, sans qui la communauté s 'effiloche ou s'engloutit. L'enseignement, de loin en loin répété, que le contrat n a de sens que continûment observé, et l'engagement fidèlement vécu et non seulement appris.
C'est pour ceci aussi que nos cérémonies retrouvent spontanément une apparence religieuse même dans nos sociétés contemporaines qui tinrent tellement à séparer le politique du religieux. Car elles savent bien qu'il n'est pas de société sans rite, sans célébration du lien qui leur donne consistance.
Les rites, tous les rites, qu'ils soient primitifs ou modernes, disent la répétition du danger. Tout se passe comme s'il fallait que la société répète le danger pour mieux le conjurer. D'où le paradoxe apparent de rites mettant en scène la violence mimétique. Il s'agit bien de représentation, de théâtre. Les rites sont à eux-mêmes un gigantesque simulacre de la violence originaire.
Il n'est qu'à regarder notre fête nationale. On eût pu imaginer que la jeune république prît la nuit du 4 Août comme symbole de la réconciliation nationale qu'elle entreprenait. Non! c'est bien la prise de la Bastille, un symbole violent, de déchirement, qu'elle saisit comme symbole d'une égalité républicaine toujours à fonder comme si l'ordre ancien menaçait toujours, comme si le sang versé purifiait la cause que l'on célèbre. Il n'est qu'à entendre notre hymne national dont certains s 'offusquent encore des accents guerriers; mais dont la violence précisément représente la crise que la jeune république sut conjurer, et sa puissance donc.
De ceci plusieurs indications sur lesquelles il faudra revenir:
Premièrement, on peut mieux comprendre pourquoi la theoria grecque et le théâtre aient la même étymologie. Toute conception du monde est une représentation, un doublet, une mise en scène. Où la vérité se joue en terme d'imitation.
Deuxièmement, on comprend mieux pourquoi la pensée humaine est si parfaitement en relation avec le concret: elle cherche immédiatement une réponse au conflit, à l'obstacle, à la violence qui met en jeu la survie.
Troisièmement, la pensée humaine ne peut alors que prendre une dimension religieuse, en tout cas rituelle, dès qu'elle éclôt. La théorie comme les rites ont la même fonction. écarter le danger en en proposant une représentation.
Quatrièmement, on comprend mieux alors pourquoi la pensée humaine n'a de sens qu'autant qu'elle soit dite, approuvée et respectée par la collectivité. Elle se voudra toujours discipline parce qu'il lui faut des disciples. La représentation a besoin de spectateurs pour être opératoire. Toute pensée émerge, devant la différence pour résoudre une crise collective; jamais une crise individuelle. C 'est bien pour ceci que la vérité ne s 'entend que de façon universelle; que les représentations s'insinuent toujours en églises, chapelles et institutions hors de quoi tout devient menace; que la pensée est violente et contraignante, puisqu'elle n 'est efficace que si la collectivité tout entière l'approuve.
Alors, oui! il était logique que le rite, pourtant supposé écarter le danger, soit si souvent violent, qu'il mette en scène sacrifice et lynchage. Car cette fois la mise en scène est voulue, maîtrisée. La collectivité, assemblée, met en scène ce que justement elle veut écarter.
Nous avons vu que le mimétisme d'appropriation avait provoqué un conflit à ce point généralisé qu'il produisit un mélange, une confusion sans pareille. Plus rien ne ressemble à rien dans la collectivité et tous sont rivaux. L 'homme craint décidément le mélange.
Ceci se reconnaît jusque dans la pensée. Il n'est qu'à lire Descartes: est-ce étonnant qu'il offre comme critères du vrai le "clair et le distinct " ? Car le mélange est de confusion. La pensée ne craint rien tant que le confus. Rappelons simplement le principe de contradiction. Deux propositions contradictoires ne peuvent être vraies ensemble. Sinon tout devient équivoque, confus et plus aucune pensée n'est possible.
Il en va de même en politique. Quand tout se ressemble, l'un et son contraire, alors la communauté n'est plus qu'un magma informe et le péril est majeur de l'effondrement.
C 'est dire qu'alors le conflit dépasse rapidement l'enjeu initial de la rivalité, qui est très vite oublié. Ceci n'est pas une fable, ni un argument spécieux: il suffit d'observer nos guerres, nos luttes sociales ou même seulement intellectuelles qui toutes finissent par dépasser leur objet initial, par s'expurger de toute cohérence extérieure, pour se nourrir d'elles-mêmes, et n'offrir plus qu'une rivalité pure comme s'il s'agissait d'un conflit métaphysique entre deux principes, deux forces également inconciliables. Alors, oui! nous sommes en plein tragique.
On reconnaîtra donc la violence mimétique en ceci qu'elle est exponentielle et qu'à son paroxysme elle débouche toujours sur une dualité inconciliable, sur un conflit absolu.
A ce titre, on observera que les églises, en période de crise, s'illustreront toujours par ce type de conflit tragique, révélé théologiquement par la figure de Satan, au risque d'ailleurs de l'hérésie manichéenne, et de l'espérance millénariste.
Parce que l'objet premier du conflit cesse alors d 'être le terme de l'enjeu, il est remarquable de constater que le mimétisme continue cependant de jouer son rôle: à la mimesis d'appropriation succède la mimesis de l'antagonisme. Tous les protagonistes se haïssent et s'opposent en ceci; mais en tant qu'ils se haïssent, ils se ressemblent tous. Ils manifestent les mêmes comportements haineux, les mêmes emportements verbaux.
Le processus victimaire, la stratégie du bouc-émissaire, revient alors à utiliser ce qui fut dans un premier temps source de division comme moyen de l'unification. Invariablement on observera que l'hostilité mimétique permettra la réunion progressive de la totalité de la communauté; contre un ennemi commun.
Il s'agit ni plus ni moins que de canaliser la violence, la mimesis antagoniste vers une victime universellement proscrite.
Qu'importent les critères qui permettront de choisir la victime et de faire se converger sur elle plutôt que sur une autre la haine et la vindicte publique. C'est ici affaire de circonstances. Certes, une différence physique, d 'origine ou de race fera l'affaire. Mais l'antisémitisme montre bien qu'à défaut d'un trait physique caractéristique qui permette de distinguer la victime émissaire des autres, on en invente. Le type-juif est une invention de l'antisémite. Sartre n'avait pas tort de déclarer que c'est l'antisémite qui crée le juif; lequel n'existe jamais que dans la tête, dans la haine de ce dernier.
Le processus émissaire consiste en ceci qu'il s'agit de canaliser la haine et la violence indifférenciée vers une victime, prise au hasard; celle-ci ou celle-là, qu'importe.' tous peuvent faire l'affaire.
Cette indifférence à l'égard de la victime est très précisément caractérisée dans les évangiles. C'est Caïphe qui manifeste combien une victime lui est nécessaire pour que le peuple entier ne meure point. C 'est Pilate aussi qui offre à la foule, ivre de rage, folle de fureur, assoiffée de haine, le choix entre Barabbas et Jésus. Peu lui importe; il le dit et proclame: Jésus est innocent. Mais puisqu'il faut une victime pour résoudre la crise collective d'indifférenciation, il en offre deux au peuple. A lui de choisir.
Comment illustrer au mieux non seulement l'innocence du Christ, mais l'innocence de toutes les victimes émissaires. Comment dire mieux, que le choix de la victime est indifférent ?
Ainsi c'est bien le même mécanisme qui, dans un premier temps divise, puis dans un second, réconcilie la communauté avec elle-même. Ce phénomène dut ne pas échapper aux premiers hommes à défaut qu'ils le comprissent toujours.
La communauté se retournant contre un seul qu'elle tient pour responsable de tous ses maux, se retrouve alors sans plus aucun objet de litige, démuni de tout objet de haine, après que la victime fut mise à mort.
Comment les hommes n'attribueraient-ils pas à cette victime des pouvoirs surnaturels puisqu'ils l'ont crue capable, à elle seule, de produire la violence généralisée, la pire des confusions sociales, puis de provoquer par sa mort la paix et la grande réconciliation? Sacrifice, étymologiquement, signifie rendre sacré; sacraliser.
Les pratiques émissaires et les rites sacrificiels n'ont pas d 'autre origine. Pour échapper à la crise, l'interdit dut alors porter sur tous les comportements mimétiques qui furent à l'origine de la mêlée, et qui devinrent ainsi sacrés, tabou. Pour renouveler la réconciliation, les rites devront quant à eux rappeler les circonstances qui l'ont rendue possible, donc refaire plus ou moins directement, plus ou moins symboliquement, les gestes de mise à mort d'une victime choisie et exécutée dans les conditions les plus proches de la situation originaire. En conséquence tous les rites seront un rappel incessant du danger que l'on avait écarté mais qui toujours menace, mais devront réaliser aussi la mise en scène de l'antagonisme universel débouchant sur la mise à mort.
Ainsi la victime est-elle bien perçue à la fois comme le responsable de la crise et comme l'acteur de sa résolution. Selon que l'accent soit mis plutôt sur sa dimension consensuelle ou antagoniste, les rites seront plus ou moins nettement sacrificiels. Offrir des oblations, c 'est souligner le pouvoir conciliateur d 'un être sacré à qui l'on demande le renouvellement de la paix; sacrifier un être c'est en souligner le pouvoir conflictuel et chercher dans la répétition symbolique de la crise l'effet salvateur qu'il eut autrefois.
D 'où, premièrement, la possibilité de rendre compte de rites, qui en dépit de leurs diversités, de leur aspect plus ou moins violent, disent néanmoins la même répétition du geste originaire.
Contrairement à Freud qui crut pouvoir interpréter les rites sacrificiels de fondation comme forme archaïque du complexe d 'Oedipe, nous pouvons plutôt les interpréter comme remise en jeu de la confusion originaire. Que les premiers rites sacrificiels fussent véritablement violents et mortifères est évident. Que la tradition judaïque fut la première à refuser les sacrifices humains, voici ce dont témoigne l'Ancien Testament. Que la messe chrétienne ne comporte aucune scène de sacrifice réel, atteste tout simplement que la violence des rites est passée, et ceci est déjà un progrès, de la violence réelle à la violence représentée, symbolique. Il n 'empêche que l'interprétation chrétienne de la Cène et du mystère de l'eucharistie, qui veut que l'hostie et le vin ne soient non pas la représentation de l'alliance, mais la concrétisation réelle de la chair et du sang du Christ, montre assez bien que la messe chrétienne remet en jeu, ici, non pas la dimension réconciliatrice de l'Alliance, mais la violence mimétique du processus émissaire. Dans la Cène, le chrétien remet symboliquement à mort l'agneau dont il porte la souffrance en sautoir! C'est assez souligner encore combien le christianisme n 'a pas renouvelé l'interprétation du processus victimaire, mais l'a seulement prolongé.
D'où, deuxièmement, la possibilité d 'asseoir le comportement humain en collectivité non sur une violence naturelle qui resterait alors inexpliquée, mais au contraire sur le mimétisme, donnée biologique et psychologique élémentaire, qui, lui, rend parfaitement compte de la violence comme effet.
Le fait même que ce mimétisme soit parfaitement intégré à la réalité psychologique, intellectuelle et désirante de l'homme, nous pousse effectivement à ne pas nous contenter d'une simple condamnation de la violence; nous empêche de voir dans la violence la seule source des conflits, des fautes et des errances humaines. Ce pourquoi il faudra bien chercher dans l'acte désirant lui-même, l'origine de la faute.
D'où, troisièmement, la mise en évidence d'un processus effectivement universel qui ne peut néanmoins fonctionner correctement qu'autant que la victime soit perçue comme coupable.
D'où quatrièmement, la nécessité qu'à la violence de la situation originaire, succède une violence répétée, même symboliquement, par le rituel. Mais la violence rituelle n'a de sens que devant la foule assemblée. Pour que le sacrifié soit sacralisé, il faut que la foule le consacre de sa haine indistincte. Si effectivement le prêtre n'est jamais seul, on le voit ici, c'est qu'il trouve dans la violence de la foule, dans la nôtre, le complice de ses exactions, de ses trahisons, de ses méprises.
D'où cinquièmement, que la connaissance du processus victimaire aurait dû logiquement faire que ce mécanisme ne fonctionne plus puisqu'il repose sur la culpabilité présumée de la victime. Que celui-ci soit proclamée innocente et alors la réconciliation ne se fera plus. Et la violence persistera. Que cette dernière fut sans cesse reproduite après la Passion du Christ illustre assez combien, au lieu de dénoncer le processus comme ils eussent dû le faire, les chrétiens l'utilisèrent plutôt.
La grande faute de notre culture réside sans doute en ceci: elle connaît la procédure sans pour autant cesser d 'y recourir.
une théorie intellectuelle de la violence
Ce qui est premier, ce n'est donc pas la violence en l'homme mais le mimétisme. Celle-là n 'est que la forme historiquement prise pour répondre à la crise fondatrice. Cette réponse, mais nous le sentions, est hâtive et déficiente. Il faudra bien considérer que l'un des termes-clé de la Révélation tient justement dans une réponse correcte à la question de la violence. Du cinquième commandement au Sermon sur la Montagne, de la présentation de l'Amour comme puissance spirituelle à la dénonciation du processus victimaire, il semble bien que le fond du message tienne à la possibilité de résoudre la violence.
Et c'est d'abord un message d'espoir. S'il est vrai que l'interdiction du meurtre signifie aussi qu'il fut commis, elle implique en même temps que la violence est évitable. Et la démarche spirituelle à la quelle nous invite le Christ est justement celle qui conduit au dépassement de la violence.
C 'est dans le mimétisme qu'il faut chercher la cause de la violence. Et ceci déplace sensiblement le problème. En effet, le mimétisme n 'est pas le propre de l'homme. Il n 'est en tout cas pas ce par quoi celui-ci manifeste son génie, ni son essence. L 'essence humaine est spirituelle; or, nous l'avons esquissé ci-dessus, le mimétisme participe beaucoup plus de la réalité psychologique et physique de l'homme que de sa dimension métaphysique. Ce n'est pas un hasard si nous dûmes faire intervenir la théorie de la thermodynamique et celle de Freud plutôt que n'importe lequel des textes de la révélation pour en rendre compte. Si les sciences, qu'elles soient physiques ou humaines, suffisent à rendre compte des processus mimétiques, c'est que ces derniers relèvent exclusivement de la matérialité de l'homme et non de son essence spirituelle.
C'est en ceci aussi que réside l'espoir implicite dans les textes de la Révélation. Certes, la violence est dépassable, mais elle ne saurait jamais l'être que spirituellement.
Ce pourquoi il faut pousser plus avant l'analyse du mimétisme.
imiter quelque chose ou quelqu'un, c'est prendre sa place, faire comme lui, reproduire son jeu jusqu'à ce qu'il semble naturel. imiter c'est recevoir une forme; c'est subir une pression extérieure et se laisser posséder par elle. Imiter, c'est donc rester à la surface des choses; survoler l 'apparence plutôt que réaliser l'être. S'emparer des attributs mais laisser l'essence intacte. Apprendre quelque chose, c'est prendre à son compte le savoir d'autrui, c'est-à-dire finalement le copier.
Il est logique que l'apprentissage mimétique soit nul d'un point de vue spirituel puisqu'il ne répond à aucune des exigences de l'être, mais seulement du corps ou même uniquement de la société. Il ne résout aucune maturité. Celui qui parle, qui serait seulement érudit, est donc inévitablement duplice: son discours, son savoir ne seront pas identiques à son moi profond. Il ne fera que réciter et ainsi joue-t-il double jeu. Il triche -peut-être même sans le savoir- mais en tout cas il est divisé; parfois il souffre mais dans tous les cas il est fragile.
Si nous ne nous sommes pas trompés il faut chercher dans le concept de sagesse la clé vers un savoir qui exhausse l 'être. Et non pas seulement dans le savoir.
"Introduisez enfin la vie et le mouvement dans le vouloir obstiné qui est le vôtre"[9]
La vie et le mouvement. Autant dire qu'ils manquent dans le savoir de l'érudit. La mimesis ne crée aucune dynamique; elle est au contraire mortifère, on l'a vu, elle fige, c'est-à-dire analyse, découpe et fixe en catégories indépassables.
Tout savoir appris qui ne ferait l'objet d'aucune intériorisation, qui ne répondrait à aucune inclination de l'âme resterait inévitablement un savoir inerte, mort; juste, peut-être parfois, mais toujours inutile, qui ne pourrait se transmettre que par mimétisme.
Nul n'est besoin d'être grand clerc pour situer du côté de la raison, la production d'un tel savoir abstrait, figé. Jamais une proposition mathématique ne pourra se vivre, s'éprouver, tout au plus se prouver!
Parce que nous ne cherchons pour le moment que les formes de la faute, il nous suffira de situer du côté de la raison, l'origine de la mimesis et donc de la violence humaine. Ce sera l'objet du chapitre suivant que d'expliquer ce en quoi la raison est productrice de mimesis.
Tout ce qui nous importe pour le moment est que l'homme, parce qu'à cheval entre deux réalités, la matière où il évolue présentement, et la spiritualité qui est son essence, se doit de maintenir une liaison entre ces deux dimensions de l'être. La raison humaine, limitée ne saura jamais correctement entendre que ce qui est d'ordre matériel. Cela nous le savons par le Message mais il suffirait au fond de relire les philosophes dans leur incapacité à appréhender correctement toute dimension métaphysique, ou alors seulement de façon contradictoire; il suffirait de relire Kant, qui pose précisément - et les démontre - les limites de la raison, pour prendre acte de la finitude de la rationalité.
Nécessaire la raison humaine l'est assurément tant qu'il s'agit d'appréhender la matière; largement insuffisante quand il s'agit d 'appréhender le spirituel. Elle se doit donc d 'établir une liaison avec le spirituel.
Toute rupture, toute dysharmonie impliquerait en conséquence qu'à la fois la spiritualité restât muette, invalide mais aussi que les occasions d 'évolution dans la matière ne fussent jamais saisies. L 'homme intérieurement divisé dont parle Paul est bien celui qui ne parvient pas à établir une solution de continuité dans son âme.
Par mimétisme on peut donc désormais entendre tout comportement, toute acquisition cognitive ou matérielle, tout changement qui, pur et simple recopiage de la réalité extérieure, donne lieu à une impression cantonnée au seul intellect, à la seule sensorialité et n'affectant en rien la spiritualité. D'où l'extrême variabilité et fragilité des comportements mimétiques, qui ne s 'harmonisant à aucune réalité spirituelle, ne sont que simples adaptations aux contingences matérielles, réponses circonstancielles à un milieu lui-même changeant. D 'où la résurrection de la violence chaque fois qu'il y a crise, et que donc les événements se modifient.
A la déchirure sociale que provoque la violence, correspond ainsi une déchirure de l'âme par quoi la spiritualité est murée derrière la suprématie de l'intellect mimétique. A cette déchirure ontologique répond une déchirure métaphysique: la tragique division de l'homme contre Dieu. L'usurpation de pouvoir où nous avions reconnu la violence est elle-même triple:
celle du sacrifice d'un innocent
celle de l'intellect étouffant le spirituel
celle du spirituel se rebellant contre le divin.
Nous comprenons mieux ainsi pourquoi la violence pharisienne ne pouvait être uniquement institutionnelle: elle n'a de chance d'être opératoire que si elle s'appuie sur la violence mimétique de la collectivité. A la violence du prêtre, répond toujours la complicité violente de la foule. Ce que disent tous les rites primitifs pour qui le sacrifice, l'immolation, l'offertoire ne sont valides que devant le peuple assemblé. Ce que révèlent également les Évangiles en opposant à la mollesse scrupuleuse de Pila te, la rage de la foule hébraïque.
Le mécanisme de la Passion fut donc exactement celui que nous avons décrit. La foule dans une mimétique de réconciliation, se rassemble autour de l'ennemi commun et croit sauver son avenir en l'immolant. Mais cette fois-ci la victime était explicitement innocente. Même le peuple, confusément, le sentit. Et du coup, le sauvetage n'aura pas lieu. La mort de Jésus n'empêcha ni la destruction du Temple, ni la diaspora, ni, plus tard, le génocide. C'est répéter encore combien le processus victimaire ne fonctionne que sur la base de la culpabilité présumée du sacrifié; ce qui n'est jamais le cas.
Ce qui est grave: non seulement la violence mimétique empêche la compréhension de l'événement mais surtout elle bloque l'intuition spirituelle de l'expérience. D'où la répétition lassante jusqu'à l'écoeurement d'une violence de plus en plus âpre et efficace, sans que jamais aucune leçon n'en soit tirée.
Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils imitent tellement, restent tant à la surface rationnelle de l'événement et de leur puissance qu'ils marchent sans le savoir (en le sachant?) contre leur propre être, puis contre le monde, puis contre Dieu.
La langue le dit bien. ils sont paranoïaques; parasites; parjures enfin!
Le terrorisme s'entend de là. Il est la violence à son paroxysme. La violence exercée en dépit de l'innocence de la victime a un nom: persécution. Nos sociétés ne cessent de la pratiquer et nos textes la racontent.
Nous n'avons plus de mythes parce que la victime est reconnue comme innocente; mais cela signifie aussi que la réconciliation ne peut plus s'opérer. D 'où nos incessantes luttes fratricides; cette violence extrême qu'est la terreur.
Clausewitz en affirmant que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens, révélait combien la violence généralisée restait encore le moyen ultime, atroce certes, mais toujours social de résoudre les conflits qui affectaient la collectivité humaine. La guerre fut longtemps le dernier avant-poste social possible avant la dissolution complète.
Mais le terrorisme, figure paroxystique d'une logique violente qui tourne désormais à vide, a ceci de particulier qu'il déplace toujours le conflit en sorte que la réconciliation soit résolument impossible. Toujours, dans toutes les guerres, les victimes mouraient d'un conflit qui n'était pas tout-à-fait le leur, mais au moins celui de leur nation. Or, avec le terrorisme, les victimes sont doublement innocentes: choisies arbitrairement, étrangères au duel, pour l'exemple d'une vengeance que l'on menace toujours d 'exécuter et qui vise non pas seulement la défaite, mais l'élimination radicale de l'autre.
De ceci, cela: l'horreur nous devient coutumière et empêche la conscience universelle de se retrouver. En mythifiant la violence, en l'érigeant en arme d'un conflit tragique, le terrorisme s'affirme comme logique mensongère en arrière de quoi l'on ne peut plus revenir.
Il n'est qu'à lire cette note écrite en Février 19 45, à Buchenwald par Léon Blum:
"Vous êtes déjà vainqueurs en ceci: vous avez fini par communiquer à l'univers entier votre haine et votre cruauté. En ce moment même votre résistance sans espoir, dans laquelle on devrait reconnaître de l'héroïsme, n 'apparaît plus que comme la marque extrême d'une férocité sadique, comme le besoin de pousser jusqu'au bout le saccage et le carnage. Et nous répondons en menant la guerre comme vous avec une rage exaspérée: de part et d'autre elle prend la figure des exterminations bibliques.
Je tremble que vous ne soyez encore vainqueurs en ceci: vous aurez insufflé de vous une terreur telle, que pour vous maîtrisez, pour prévenir les retours de votre fureur, nous ne verrons plus d'autre moyen que de façonner le monde à votre image, selon vos lois, selon le Droit de la Force.
Ce serait votre victoire véritable. Dans une guerre d 'idées, le parti qui triomphe est celui qui a inspiré la paix."[10]
Ce texte est terrible; terriblement menaçant. Il montre bien que celui qui lutte, accepte aussi la logique de la lutte, et manque souvent d'épouser la logique même de son adversaire. [e qui est épouvantable dans le terrorisme qui ne connaît ni innocent ni coupable, ni champ de bataille ni arrière, qui ne distingue jamais entre les moyens et les fins, pour qui surtout tous les moyens sont bons; ce qu'il y a d'inexorable dans le terrorisme tient précisément en ce que la victime elle-même finit par ressembler au bourreau. Nous aurons à nous demander plus d'une fois si les nazis n'ont pas effectivement emporté la guerre; mais il est sûr en tout cas, que si le mal l'emporte, alors même le bien finit par lui ressembler. Le mélange est à son comble; la violence parce que le mimétisme.
Notre siècle laisse la désagréable impression que le politique ne maîtrise plus rien de la matière qu'il prétend modeler, comme au moins il pouvait autrefois en donner l'illusion. Il faut y lier le mode contemporain de résolution des conflits sous l'égide du terrorisme.
De part et d 'autre la réalité nous échappe, demeure rétive à toute intervention, ici, comme là, le jeu tourne à vide. Pour rien.
La puissance est investie au maximum; pour un effet nul. C'est bien ici le demier effet de l'entropie, du désordre pur. L 'investissement d'énergie est maximal, de violence ou d'espoir. Mais le rendement est presque nul: le conflit ne se résout pas; les espérances ne sont pas satisfaites mais le prix à payer est énorme. L'horreur et le déchirement.
La formule biblique était donc juste. La violence se fonde sur le mensonge. Mais ce mensonge est triple:
le supplicié est innocent.
le sacrifice était de déchirement et non de réunion
la démarche se voulait de vertu; elle reste de simple imitation.
On comprend donc que la faute prend toujours la forme intellectuelle de l'imitation. de la ressemblance; de l'indifférenciation.
Politiquement elle produit le processus victimaire par quoi toute religion jusqu'à se jour se fonda plutôt sur la violence que sur l'Amour.
Théologiquement elle prend la forme de la plus considérable des méprises du catholicisme qui, au lieu de dénoncer le processus victimaire, le prolongea par son dogme imbécile de la Rédemption, se condamnant par avance à laisser se perpétuer la violence; et même ce qui est d'autant plus impardonnable, d'en être parfois l'instigatrice.
Spirituellement, elle produit une déchirure entre les dimensions de l'homme; offrant l'irrécusable prééminence dogmatique et mortifère à l'entendement rationnel au risque d'emmurer la spiritualité et de l'étouffer.
Moralement, elle produit une confusion des valeurs et progressivement une dévalorisation de celles-ci.
Le pont a été détruit; car la plus grande des violences réside sans doute dans l'incapacité humaine à entendre désormais la Révélation. Cette surdité qui reflète dans la mort du Christ, est spirituellement mortifère; elle est la forme même de la violence que nous cherchions:
Le Verbe était dans le monde et le monde fut par lui Et le monde ne l'a pas connu Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. [11]
[1] Jn, 8, 44
[2] on remarquera qu’en allemand, à l’identique, le concept de Vorstellung se joue de la même métaphore
[3] on lira ainsi, avec effroi, la mâle assurance d’un R. Hœss, dont le journal relate la bonne conscience, la rigueur administrative, la compétence profesionnelle avec laquelle cet homme géra Auschwitz comme s’il se fût agi d’une entreprise manufacturière ordinaire! L’horreur est bien là: dans l’absolue banalité sous laquelle elle se commet, se perpétue, se relate.
[4] On pourrait aisément, à ce titre, opposer la fameuse formule de Maître Eckart :
«Dieu est un être plus intérieur à moi que moi-même»
à ce que nous venons d’énoncer ici: L’horreur est en nous réalité plus profonde que la conscience. Si l’angoisse métaphysique doit avoir un sens, sans doute réside-t-il moins dans la conscience de la mort, qui effectivement rend notre parcours absurde, mais n’interdit néanmoins pas que l’on tentât de donne un sens à celui-ci par l’acte décisoire de notre libre-arbitre., qu’il ne s’insinue dans cette révélation d’un mal dont nous pourrions être en chaque instant l’acteur. Le salaud, le criminel, ne peut alors plus jamais être seulement l’autre, mais nous demain, maintenant, sans coup férir. Sans transition, pour peu que les circonstances s’y prêtent. Alors oui! l’angoisse. Il faut pouvoir à ce moment précis, être néanmoins capable de se regarder dans la glace, dans vomir d’effroi, de dégoût ou de désespoir. La victoire métaphysique se joue ici, dans la capacité à surmonter cette angoisse, et d’amimer l’humain en nous, malgré tout..
[5] P VALERY
[6]JJ Rousseau in Le contrat social, 77 et sq
[7]Platon, in République, X, 606c
[8]J Monod in Le hasard et la nécessité
[9]Il,22,152
[10]L Blum in Notes d'Allemagne
[11]Jn,l,10-1 1