

|
|
LaïcitéParce qu'elle est, historiquement un des fondements de la république, sitôt que l'on semble peu ou prou vouloir la remettre en question, le débat rebondit. Il en va de même pour l'école et ce n'est sûrement pas un hasard si les deux questions sont en réalité liées. Les propos récemment tenus par le président à Ryad et au Latran semblaient vouloir le faire! D'où aussi la réponse si rapide d'H Guaino. Rappelons simplement deux choses :
Laïcité positive : une impostureParler, comme on le fait désormais, de laïcité positive, c'est supposer qu'il y en eût de négative contre quoi il faudrait lutter, ou qu'à tout le moins il faudrait dépasser - c'est le sens des interventions d'H Guaino. Mais ceci ne va pas sans une double malhonnêteté :
Laïcité et démocratieEn réalité je crois bien que l'on peut effectivement entendre la laïcité de deux manières :
Hestia, Déesse du foyer, protectrice des villes et
des colonies renvoie Mais entre assurer un tel lien entre des espaces de nature différente dont il importe de garantir l'harmonie et instituer un espace, donc une perspective qui se veuille à égale distance de toutes les autres, il y a une différence essentielle. Dans le premier cas, il y a reconnaissance des différences qualitatives, des intérêts particuliers dont on se charge simplement de garantir l'existence en empêchant l'un de prendre le pas sur l'autre; dans le second, il y a égalité entre toutes les parties prenantes et souci de n'envisager que ce qu'il y a de commun. De la même manière il me semble que concevoir la laïcité comme un espace géométrique c'est concevoir une réalité politique neutre, non dans le sens où elle n'existerait pas, mais dans le sens où elle exclut les considérations religieuses de son espace, pour les réserver à l'espace privé. Laïcité de l'état signifie que ce dernier n'a pas à connaître des choix religieux, non plus que des appartenances pour n'envisager que le citoyen en tant qu'il est libre dans l'espace public. Il y a ainsi un rapport assez étroit entre la question de la laïcité et celle du communautarisme : il est juste d'y voir le fondement de la république. 3 Les forces en présenceC'est assez dire que sous le vocable de laïcité ouverte, il y a en réalité reconnaissance, sous l'individu, de la communauté, du groupe supposé le dépasser. C'est dire que sous la communauté, on laisse se dérouler cette logique de l'identité dont on a déjà souligné avec Serres combien elle était une faute logique; dans la mesure où elle confond appartenance et identité et fausse par là même l'idée même d'égalité. Si en 1905 le débat mit en présence d'un côté un mouvement anti-religieux, des modérés - autour de Briand - et un mouvement anti-laïque concordataire; s'il est vrai qu'à l'époque parmi même les républicains d'aucuns prônèrent le maintien du statu quo en ceci que le concordat permettait une surveillance et une mise sous tutelle de l'église, la victoire même du courant Briand permet de comprendre que ce que voulut alors la république c'est, non pas un rapport de force mais la relégation des opinions et pratiques religieuses dans la sphère privée. Aujourd'hui les forces en présence sont bien différentes. La demande de réforme de la loi de séparation ne vient pas des églises mais du politique lui-même et surtout de Sarkozy. Qu'y comprendre?
Désormais s'opposent le courant sur de la laïcité (Pena-Ruiz notamment) et cet appel à une laïcité ouverte; tout juste peut-on observer une position mitoyenne (Ricoeur et Canto-Sperber) aspirant à empêcher que laïcité ne rime avec exclusion. Ce débat révèle une criseToute la question reste de savoir de quelle crise il s'agit ! On peut en soupçonner trois en réalité :
Ce que l'on cherche à nous vendre c'est la crise du sens ! A nous vendre l'idée que cette crise est fondamentale et fondatrice d'un nouvel ordre. Que ce sens est à rechercher non pas dans l'espace politique mais dans celui du religieux . Et c'est en cela que le discours est une régression parce qu'il nous invite ni plus ni moins à l'enterrement du politique. Qu'il y ait une crise, en partie larvaire, de la démocratie n'est pas douteux . C'est ce qui ressort du débat paru récemment dans le Magazine littéraire entre M Gauchet et Pierre Manent. Une crise largement entretenue par l'individualisme 6 que la démocratie a contribué à créer et légitimer. De ce point de vue il n'est pas sot de considérer que la crise est immanente à l'idée même de démocratie et donc, façon optimiste de poser le problème, certes, que la démocratie ne se survit et développe que dans et par sa propre crise . Toute la question est bien de savoir si désormais la démocratie était à ce point épuisée qu'il lui fallût chercher du côté du religieux de quoi nourrir sa dynamique ou si au contraire elle possédât encore assez de puissance pour nourrir le projet d'un avenir qui la justifie.
Crise qui porte sur les éléments constitutifs du monde humain expression laissant bien entendre qu'effectivement nous serions dans une crise des fondations voire une crise fondatrice mais qui pose la question de la place qu'occupe dans l'histoire cette sortie du religieux :
C'est, décidément, commettre une faute logique que d'en déporter la réponse sur le religieux (confondre effet et cause comme le souligne Bouveresse ), une faute politique que de supposer la république incapable de répondre à ses propres enjeux.. Relire Morin ! décidément plutôt que ces pâles pilleurs de troncs !
1) TLF 2)voir 3 voir observatoire du communautarisme Chez les Romains comme chez les Grecs, la déesse qui s'appela Hestia ou Vesta a dû n'être d'abord que la flamme du foyer envisagée dans sa fonction, je veux dire dans son intention bienfaisante. Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion Selon la formule de Durkheim, les forces religieuses sont des puissances morales dont l’autorité « n’est qu’une forme de l’ascendant moral que la société exerce sur ses membres ». A travers la divinité, c’est en réalité la puissance et la souveraineté de la société que vénère sans s’en rendre compte l’individu. Mais que se passe-t-il lorsque l’ascendant moral que celle-ci exerce sur ses membres diminue au point que le groupe concerné puisse sembler menacé de dissolution pure et simple (comme certains craignent que ce ne soit actuellement le cas, en raison du triomphe complet de l’individualisme, dans les démocraties modernes) ? La solution ne peut résider que dans une aptitude de la société à se modifier et à se réorganiser de façon à retrouver une autorité et un prestige suffisants, et sûrement pas dans une tentative qui pourrait être faite pour réintroduire artificiellement de la religion, au sens usuel du terme, dans les institutions, dans les comportements et dans les mœurs, avec l’espoir de réussir ainsi à recréer ou à raffermir le lien social. Croire le contraire reviendrait à prendre l’effet pour la cause et le reflet pour l’original, puisque la force dont l’action est ressentie par l’individu dans l’expérience religieuse n’est en réalité qu’une expression du pouvoir que la société exerce sur lui. 5 on songe évidemment à ce texte de Tocqueville |
6 autre façon aussi de dire aussi que
l'heure est à la pensée du politique au moins autant que de la république,
de la démocratie au moins autant que de la gauche ( ce que j'ai tenté de
commencer
ici )
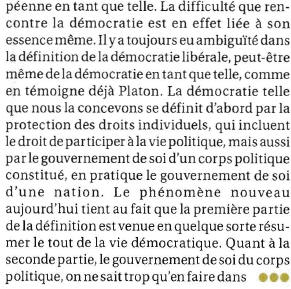 |
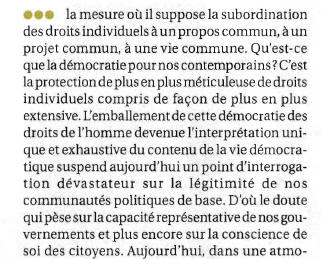 |