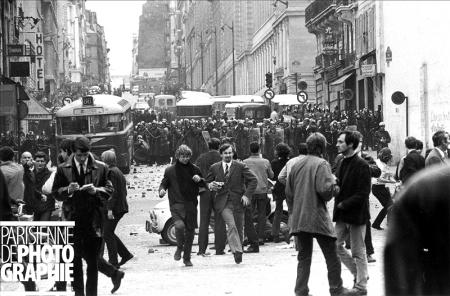Paris,
29 novembre 2007
Sous l'apparence ....
Des étudiants dans la rue qui protestent contre la énième
réforme de l'Université. Il fut un temps où les étudiants regimbaient devant
l'absence de réforme. Clairement l'ombre de 68
1 plane
invraisemblablement devant toute réforme. Une manifestation étudiante ne
sera jamais tout à fait une manifestation anodine.
Ici des étudiants, des lycéens plutôt, coincés entre
l'inflexibilité gouvernementale, l'ambivalence si faible de leur syndicat et
une vraie crise - celle de l'université ! Comme à chaque
fois, mais n'est-ce pas après tout l'incontournable ritournelle de la langue
de bois, l'on stipendie, d'un côté, la manipulation politique (d'extrême
gauche, évidemment); l'on dénonce de l'autre l'orfraie de la privatisation !
A droite, on s'étonne que ne travaillant pas, on puisse néanmoins vouloir
faire grève; et l'on dénonce, signe évident de la récupération, la présence
de lycéens plus enclins à faire la fête qu'à réellement protester contre une
réforme, qu'étant jeunes, ils ne seraient pas susceptibles de pouvoir
comprendre.
A gauche, on saisit la balle au bond parce que toucher à
l'université, comme à l'école, c'est toucher aux fondements de la république
!
En réalité, la manifestation à l'instar de la
grève, est la pointe avancée
du désordre dans l'ordre; du sacré dans le profane !
Sa
définition est éclairante: s'il s'agit dans tous les cas de
l'expression, de l'exhibition force est de constater que l'origine est bien
religieuse. Connaissance que Dieu donne de
lui-même en se manifestant dans le monde sensible; p. méton., apparence
sensible manifestant Dieu. La manifestation est une incarnation. Elle
est un état d'exception précisément en ceci que ce qui est ordinairement
hors système, y rentre, en tout cas s'y exprime.
Le simulacre
Dans un état de droit, le
peuple est hors-jeu puisqu'il est représenté . S'il y rentre, tout est
bouleversé 2 ! A moins que l'on ne soit que dans
la représentation, dans le simulacre ! Ce qui est le cas et c'est bien pour
ceci que la manifestation est intéressante.
 |
ou bien elle est irruption du
principe dans le système et alors pour éviter que le système n'explose on
organise cette intrusion en tentant de lui fixer des limites. Elle devient
alors, avec la grève, la frontière entre la révolution et l'ordre
parlementaire et républicain. On mime la révolution pour ne pas la faire
tout en évitant soigneusement d'éviter d'atteindre ce point de non retour
qui ferait basculer de la représentation au réel. |
 |
ou bien, elle n'est d'emblée
que simulacre, quelque chose comme le rituel de la vie sociale et politique
et, derechef, la manifestation se réduit à cette mise en scène bien
huilée des rapports de force que l'on va d'autant plus simuler dans
l'outrance et la violence verbale qu'elle n'est précisément là que pour
éviter d'y sombrer. On peut dès lors reprendre l'analyse de Girard. La
ritualisation des rapports de force n'est en fin de compte qu'un moyen pour
le système de se réconcilier et, par la bande, de se trouver un leader, un
symbole sacrificateur en même temps qu'un coupable. |
Pour que se dénoue la crise, il faut pouvoir se réconcilier
dans la détestation commune d'une victime expiatoire. Le rôle du politique,
et il le demeure tant qu'il y parvient, tient dans sa capacité à désigner à
la vindicte publique cette victime.
La manifestation est une contrefaçon de journée
révolutionnaire : à ces moments-ci tout semble être possible, ou le devenir;
l'acteur le plus humble s'exhausse en grand homme. Comment dire cette
ivresse par quoi la combinatoire des compossibles s'enchevêtre si
parfaitement que chacun croit miraculeusement délaisser les rives triviales
du quotidien pour enfin atteindre ce contrefort où l'on croit que l'histoire
se fait.
La fête, qui gît en chaque manifestation, sous la gravité
de chaque fête, tient à cet exhaussement-ci, à cette élévation vers le
sacré; à ces pérégrinations le long de la bordure sacrée du politique
3. On
remarquera, et c'est bien entendu toute la différence entre les grandes
journées d'autrefois, entre les grèves générales et les manifestations
frôlant l'insurrection qui hantent notre imaginaire, notre histoire ou nos
peurs , que désormais les grèves ont déserté - et les manifestations aussi -
le terrain politique pour se cantonner aux revendications sociales, aux
raideurs devant telle ou telle réforme sectorielle - que ces raideurs soient
justifiées ou non ! Les manifestations d'aujourd'hui sont les lointaines
hypostases, les ultimes rémanences des luttes d'autrefois : elle en
entonnent les rythmes mais n'en ont pas le souffle.
Deux lectures sont possibles:
 |
celle de Girard, pour
qui, avec le christianisme, le mécanisme victimaire ne fonctionne plus parce
que l'on sait désormais que la victime est innocente si bien que les forces
antagonistes n'ont pu qu'à courir leurs extrêmes ou bien s'écrouler. |
 |
celle qui consisterait à supposer au contraire la
sécularisation du politique: la démocratie ennuyée et ennuyeuse, vautrée
dans son confort et ses évidences, n'aurait plus, aux antipodes de toute
générosité et culture qu'à mimer sa propre histoire
4 . Et l'on sait que si
l'histoire ne se répète jamais, il lui arrive parfois de bégayer: la
première fois elle est tragique; la seconde ridicule ! Dès lors,
manifestations et grèves ne seraient plus que les passages obligés d'un
rituel vide, les vaines gesticulations d'une dogmatique sclérosée : quelque
chose qu'il faut faire mais qu'on ne comprendrait plus ! |
Une figure du tragique
A la croisée, en ce lieu où s'ensemence le réel puisqu'il
est décidément question de rite de fondation; parce qu'il apparaît
décidément que le temps n'y ait nulle prise non plus que l'effort humain;
qu'il nous y faille sans cesse répéter cris et simagrées mais que nonobstant
le geste s'effondre en gesticule; là, oui, où s'organise notre
être-au-monde, s'affirme une forme cruelle de tragique où l'épopée, pour
désirable qu'elle soit, se révèle impossible.
Il n'y a pas de place pour le peuple; pas de place pour le
souverain ! Nécessairement dehors, ou condamné à la scène ! Pas de place
pour le héros qui, lui aussi, reste à la lisière ! Ni dedans, ni dehors! Il
rentre, le système s'effondre ! Il est absent, le système se nécrose et
pervertit ! Le peuple est décidément une icone - qui doit le rester.
Le Christ est crucifié d'avoir voulu rentrer dans
l'histoire; Moïse meurt sans entrer en terre promise; Romulus emporté par la
foudre, roi mais fratricide pour prix de son intrusion; le peuple,
terrifiant quand il s'incruste, n'est jamais aussi aimable qu'absent, muet
... représenté !
Impossible immanence ; tragique transcendance du sacré !
Telle est l'aporie du politique !
Errer le long de cette ligne de partage sans devoir, ni
surtout pouvoir, incliner d'un côté ou de l'autre; rester non dans
l'indécision mais dans le virtuel ! C'est bien une question de morale ! Je
ne sais juste plus s'il vaut mieux rêver du politique sur la rive du sacré,
ou ambitionner le sacré sur la rive du politique ! Je sais seulement
qu'entre le monarque et le prêtre la connivence est plus profonde qu'il n'y
paraissait !
Je dois à cette impétuosité estudiantine de l'avoir compris
ce soir ! |
|

|
1) dont notre président tente tellement d'effacer les
ultimes rémanences
2) voir
notamment
3) C'est toute la question du politique:
évoquée
ailleurs! Mais s'agit-il de la frontière politique du sacré ou de la
lisière sacrée du politique ? La question n'est pas anodine quand même il ne
s'y joue que le prisme d'une perspective vue d'ailleurs !
4) Je pense naturellement à ce passage,
terrifiant à sa manière, esquissant des
perspectives bien peu amènes :
Tocqueville, De la démocratie en Amérique
"Je pense donc que l'espèce d'oppression dont les peuples
démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédée dans
le monde; nos contemporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs
souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise,
exactement l'idée que je m'en forme et la renferme , les anciens mots de
despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il
faut donc tâcher de la définir, puisque je ne peux la nommer.
Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se
produire dans le monde: je vois une foule innombrable d'hommes semblables et
égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et
vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à
l'écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants
et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine; quant au
demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas;
il les touche et ne les sent point , il n'existe qu'en lui-même et pour lui
seul, et, s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a
plus de patrie.
Au-dessus de ceux-là s'élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge
seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu,
détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance
paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à
l'âge viril; mais il ne cherche au contraire, qu'à les fixer irrévocablement
dans l'enfance; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne
songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il
veut en être l'unique agent et le seul arbitre; il pourvoit à leur sécurité,
prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs
principales affaires, dirige leur industrie, règle leurs successions, divise
leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser
et la peine de vivre ?
C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du
libre arbitre; qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit
espace, et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même.
L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses : elle les a disposés à
les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait.
Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque
individu, et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la
société tout entière; il en couvre la surface d'un réseau de petites règles
compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les
plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour
pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit,
les plie et les dirige, il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans
cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche de naître; il ne
tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète, et
il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides
et industrieux, dont le gouvernement est le berger.
J'ai toujours cru que cette
sorte de servitude, réglée, douce et paisible, dont je viens de faire le
tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes
des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible
de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple." |
haut de la page
|