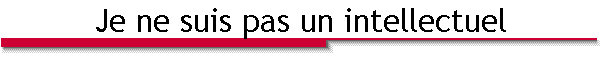
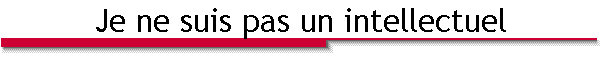
|
|
Je ne suis pas un intellectuel 1 !
On s'en doutait un peu ! Plus sérieusement, cette remarque, qui se veut anodine traduit la consécration de ce pragmatisme qu'on appelait autrefois réalisme politique, et que, plus loin encore dans l'histoire, on nomma opportunisme, avant que le terme ne prît une connotation péjorative. C'est aussi le discours très marketing politique visant, de manière furieusement démagogique, à se rapprocher d'un peuple évidemment sot. Car c'est bien de relent populiste dont il s'agit ici ! Et revoici, inévitablement le bon sens dans son inévitable lute contre les idéologies. Ce que dit Sarkozy est simple : au delà des idées qui, inutilement nous divisent, il y a le réel et celui-ci nous rassemble 2 ! Tâchons de faire au mieux, utilisons toutes les solutions possibles (d'où le je n'ai pas de tabou) ! Ce faisant le président opère une triple rupture : ►avec la tradition de dirigeants intellectuels, ou se piquant au moins de culture 2bis ►avec l'histoire politique française qui voulu toujours inscrire sa démarche à partir des grands principes des Lumières ►avec le clivage gauche/droite auquel il impute dogmatisme et frilosité idéologique et donc paralysie.
On pourrait dire de Sarkozy, d'une certaine manière, ce que Heidegger disait de Marx 3. Comment ne pas songer effectivement à l'aporie soulevée par la XIe thèse sur Feuerbach : comment vouloir changer le monde sans préalablement disposer d'un système de pensée qui rende ce changement nécessaire et possible ? Il en va de même ici : on voit mal comment une action politique pourrait ne pas s'appuyer sur une lecture du réel et donc, sur un système idéologique. Celle-ci est libérale et l'on sait combien elle se veut pragmatique plus qu'idéologique. C'est bien tout le malheur du libéralisme de n'avoir jamais su faire la différence entre idéologie et pensée , entre théorie et prise de parti. Ne pas vouloir de pensée, c'est déjà en avoir une; vanter le culte du réel, exiger la prévalence du fait sur la théorie, c'est déjà une théorie ! C'est surtout se mettre dans la posture de n'avoir pas à justifier ses présupposés idéologiques ! Derrière tout ceci on peut retrouver plusieurs mythes qui hantent la dernière décennie :
Mais on retrouve aussi cette exigence de la restauration du politique: après deux mandats chiraquiens ternes et peu marquants, la rage de marquer son temps ne va pas sans l'illusion de pouvoir s'échapper des pesanteurs sociologiques et historiques. D'où:
Sarkozy est un manager, une sorte de DRH : il manage le pays; il ne le dirige pas; il gère les français ! Et ce faisant il en digère toute l'histoire, toute l'universalité ! Avec lui, la république est une entreprise ! Et le projet politique un plan de conquête d'un marché ! Il n'y a que les gestionnaires pour oser penser que la réalité soit neutre ! Mais les faits sont têtus ! Aujourd'hui, demain, le politique que l'on crut avoir chassé, surgira bien par la bande, de là où on ne l'attendait pas! ou plus !
|
1) On sait que le terme apparut, en tant que substantif, à l'occasion de l'Affaire Dreyfus, par la publication dans l'Humanité, dirigée par Jaurès, d'un manifeste des intellectuels où l'on trouva, notamment la signature de Blum, Proust etc... on trouvera sur le site de l'ENS une belle exposition sur l'Affaire Dreyfus à écouter, notamment cette conférence 2) mais est-ce si vrai que cela ! 2bis doit-on citer un Guizot , un Thiers qui écrivirent des Histoire de la Révolution Française qui se lisent encore ? Pour ne parler que des premiers qui viennent à l'esprit ! 3 voir cette vidéo Loin de moi, évidemment de vouloir assimiler en quoi que ce soit l'un à l'autre ! |