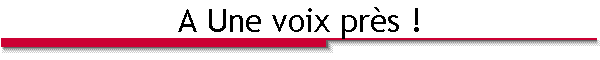
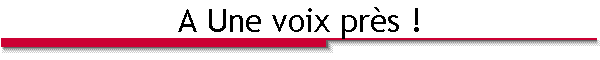
| La réforme | le précédent de l'amendement Wallon | Quelle lecture? |
| La constitution de 58 | Texte et pratiques | La réforme de 2008 |
|
|
|
|
la division du camp monarchiste | |
|
le retournement stratégique d'un Gambetta qui d'enragé républicain se mue lentement en tacticien opportuniste | |
|
le retournement de certains votes monarchistes. |
On peut toujours avoir de ce type d'événement une lecture circonstancielle, au premier niveau, et alors, inévitablement, paraîtront les trahisons, les intérêts veules ou les lâchetés des uns ou des autres. On peut aussi, et d'après nous, il vaut mieux, tenter de comprendre les forces et les mutations à l'œuvre qui produisirent ces changements !
Il en va de même pour la récente modification de la loi constitutionnelle : il est vrai que sans le vote du président du Congrès (qui traditionnellement s'abstient dans de telles circonstances), sans celui positif de J Lang la révision eût échoué ! On peut toujours gloser sur les manipulations et autres pressions sur les parlementaires de la majorité initialement réticents à la voter mais de telles analyses ne mènent pas très loin!
Sans doute vaut-il mieux prendre du recul et s'adosser aux différentes temporalités à l'œuvre dans le processus politique et considérer que cette voix de majorité fait partie des ruses de la raison !
Le temps était à la République. Les différentes restaurations depuis 1815 se sont toutes soldées par des échecs et, manifestement, l'instabilité politique du siècle aura grevé le décollage économique du pays - qui le paiera très cher ! Le corps électoral en 70 voulait sans doute la république mais voulait surtout la paix : les républicains - incarnés alors par Gambetta - représentant la poursuite à outrance de la guerre - il vota pour la paix et donc contre les républicains. La paix faite, et toutes les élections partielles en témoignent, il vota républicain !
Le temps était au libéralisme économique et certainement plus au corporatisme d'ancien régime : le projet de restauration du Comte de Chambord était anachronique, suranné, condamné d'avance ! Les orléanistes, de ce point de vue, étaient plus proches des républicains que des légitimistes : quand il s'avéra que la question du drapeau devenait irréfragable, ils versèrent où allaient leur conception moderne et résolument bourgeoise de la société française! Nul doute qu'une restauration de type Chambord n'eût pas tenu ! Ils voulurent la stabilité : force est de constater qu'en dépit de ses faiblesses, qui apparurent plus tard, cette constitution républicaine si mince -trois lois seulement - la leur apporta : le régime tenu 70 ans !
Du coup on peut considérer que la temporisation de Thiers, dès 70, consistant à obtenir de la Chambre, le pouvoir de faire la paix, et de ne décider de la forme constitutionnelle du régime qu'après cela, que cette habileté politique qui fit que durant presque cinq ans, la France vécut sous une république qui ne dit pas son nom, sous un régime transitoire sans règle véritablement définie, sous le système monocaméral d'une Chambre dont le mandat n'avait aucun terme et qui fonctionnait à la fois comme une constituante et comme une législative, fut la forme historique que prit, dans notre histoire, à la fois l'entrée dans la modernité et le solde de tout compte de la Révolution de 89 ! A l'opposé des débats idéologiquement intenses des incertitudes révolutionnaires (de 89 à l'empire) on eut ici un débat a minima, pragmatique ... et terriblement efficace ! La France s'habitua à la république sans nom, vit que l'instabilité avait changé de camp : le jeu habile aura fonctionné puisque progressivement les élus non républicains cesseront d'être une force politique d'importance pour ne devenir qu'anecdote ou force d'appoint ! Le débat était désormais entre républicains et ceci dès le coup manqué de 1877 !
Ne jamais, pour la comprendre, oublier qu'elle trouve son origine profonde dans le désastre de 40 ! Le coup de barre si fortement marqué vers l'exécutif, au détriment du législatif, provient de la conscience aiguë que si en 40 il y avait eu un véritable chef d'Etat, le renoncement pétainiste n'eût pas pu avoir lieu ! Mais pour que ceci fût possible, pour citer de Gaulle, encore eût-il fallu qu'il y eût un chef, qu'il y eût un Etat ! Si la république de 75 avait su résister à la guerre de 14, elle succomba à la défaite de 40 !
Remarquons d'emblée deux points:
|
même s'il n'y eût pas de vote populaire en juin 40 mais seulement parlementaire pour conférer les pleins pouvoirs - y compris constituants - à Pétain, nul doute que ce dernier eût le soutien du corps électoral. Ici encore, comme en 70, l'adhésion va à la paix d'abord, à la forme constitutionnelle du régime dans un second temps seulement. De Gaulle, et les rares qui le suivent alors, représentent à l'instar du Gambetta de 70, un enragé de la poursuite de la guerre : il n'est pas suivi ! Les restaurations réactionnaires n'ont d'opportunité en France que sur fond de désastre et de défaite ! | |
|
l'heure était manifestement aux pouvoirs forts et la lecture faite par de Gaulle est que seul un exécutif fort saurait résister aux menaces dictatoriales des régimes fascisants ou soviétiques. Toute la question restait de trouver une forme républicaine à ce pouvoir fort ! Que De gaulle en Août 44 refusa de proclamer la République au balcon de l'Hôtel de ville reste un signe fort : il s'inscrivait dans la continuité et non dans la rupture en estimant que la IIIe était toujours en vigueur et que tout acte politique de la période Pétain était nul et non avenu. Le référendum qui suivra en posant la double question de la restauration de la constitution de 75 ou du vote d'une nouvelle constitution allait dans ce sens. Le départ du pouvoir en 46 pour cause de retour du régime des partis, qui traduisait en fait le refus des forces politiques en présence d'un exécutif fort, également ! L'apparition de superpuissances (USA v/s URSS), la guerre froide qui s'en suivra confortaient de Gaulle dans la certitude où il était que seul un régime fort saurait être à la mesure des défis qu'il devrait assumer : reconstruction, nouvel ordre mondial manichéen etc... Nul doute à cet égard que la culture militaire et maurrassienne de cet homme dut le conforter dans cette certitude ! |
La constitution de 58 voulut régler un débat que ni la Constitution de 91, à cause de la place réservée au Roi, ni celle jamais appliquée de 92, ni surtout celle de 75, parce qu'instituée, pragmatiquement, au fil de l'eau des usages parlementaires ne surent régler : celle des rapport entre l'exécutif et le législatif :
|
indépendance stricte des pouvoirs dans l'orthodoxie théorique d'un Montesquieu avec le risque que les deux se paralysent l'un l'autre | |
|
dépendance de l'un à l'autre avec le risque que l'un succombe à l'hégémonie de l'autre ! |
Le pouvoir présidentiel à l'américaine sembla longtemps inapproprié à la France qui ne bénéficiait pas d'un système bipartisan comme aux USA ou au Royaume-Uni ! Le régime parlementaire quant à lui aboutit vite à la prédominance du législatif et donc à l'instabilité gouvernementale !
La constitution de 58, surtout avec la modification substantielle de 62 ( élection du président au suffrage universel) apparaît comme un véritable compromis entre le régime parlementaire et le régime présidentiel :
|
maintien de la responsabilité gouvernementale devant la chambre (motion de censure) qui en fait un véritable régime présidentiel | |
|
apparition d'un chef de l'état de plein exercice et non plus arbitre symbolique vers quoi se déplace irrésistiblement le centre de gravité du pouvoir exécutif, mais d'un président politiquement irresponsable (hormis le cas de haute trahison) ce qui en fait un régime présidentiel ! |
Un régime hybride que celui de la Ve République, ce qui en fit vraisemblablement la force et la longévité, même si on put croire le contraire à ses débuts. D'avoir pu survivre aux trois cohabitations aura été plutôt un bon signe même, si progressivement c'est la nature du régime qui aura changé !
Un régime présidentiel hybride au moins dans le sens où il est à la fois pleinement acteur de la vie politique - et même le principal - alors même qu'il conserve le rôle d'arbitre et de recours. Or ce qui aurait pu être la faiblesse du système - cet arbitre qui est en même temps dans le jeu- aura fini par être une force.
Remarquons néanmoins que le primat de l'exécutif résulta au moins autant de dispositions constitutionnelles que du règlement intérieur du parlement :
|
maîtrise de l'ordre du jour par le gouvernement et non le parlement | |
|
majorité des élus et non des votants requise pour une censure qui rend celle-ci hautement improbable | |
|
incompatibilité des fonctions ministérielles avec le statut de parlementaire | |
|
le 49-3 | |
|
définition du domaine de la loi plutôt que de celui du règlement ce qui réduit logiquement le premier et étend le second |
Or tout ceci aura pu se faire alors même que le texte définissant le rôle du président de la république est quasiment le même que celui de la constitution de 1875 .
|
le rôle de président du conseil (premier ministre) n'avait pas été prévu initialement. La loi conférant la présidence de la République à Adolphe Thiers conférait en réalité le pouvoir exécutif sans autre distinction. | |
|
l'interdiction pour le président de la République de s'adresser directement au parlement, la seule possibilité pour lui restant le message lu par le président de la chambre n'est jamais que le résultat d'intrigues d'une droite monarchiste qui, voulant se débarrasser de Thiers et de l'influence qu'il possédait sur les élus n'avait pas trouvé d'autre moyen que celui de messages lus et non soumis à vote ! | |
|
après la démission de Thiers et l'élection de Mac Mahon, habitude fut prise d'un vice-président du Conseil qui ne se transforma en présidence en titre qu'après la crise résultant des élections de 1876 qui amenèrent 343 républicains à la chambre. Toute la tradition républicaine fonctionna ainsi avec une fonction qui n'avait pas été prévue, et qui ne figurait pas dans le texte constitutionnel - la totalité du pouvoir exécutif étant conférée au président de la République. | |
|
La disparition à partir de Grévy d'une présidence forte résulte à la fois du coup malheureux de mai 77 (Mac Mahon dissolvant la chambre pour se débarrasser des républicains au profit d'une majorité plus conservatrice) et de volonté alors partagée par tous de Grévy, républicain de 48, d'éviter tout césarisme (N'oublions jamais le précédent fâcheux du coup d'état de 1852!). Dès lors tout ce qui, dans la constitution de 75 pouvait tempérer le pouvoir de la chambre allait disparaître (dissolution surtout, plein exercice du pouvoir présidentiel) . | |
|
le septennat lui-même ne fut qu'une façon pragmatique de donner des gages aux monarchistes pour leur laisser le temps de solder leurs différends internes! |
La personnalité même de de Gaulle, son rôle historique ne pouvait que marquer les débuts de la Ve :
|
en dépit de l'article stipulant que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il s'avéra vite qu'en réalité cette dernière se concevait et menait à l'Elysées au moins pour ce qui concerne l'essentiel : politique étrangère; défense etc. | |
|
la notion de domaine réservé qui pour n'être pas constitutionnelle n'en possédait pas moins une réalité s'avéra vite un leurre : dès Pompidou, assurément avec Giscard, il apparut clairement que la réalité du pouvoir s'exerçait à la présidence et non à Matignon, bousculant ainsi l'équilibre des pouvoirs puisque l'enjeu d'une responsabilité gouvernementale devenait nul ! | |
|
les trois cohabitations auront révélé surtout qu'en tout état de cause, le primat demeurait à l'exécutif, celui-ci dut-il traverser la Seine dans ces cas-là ! Mais à aucun moment, et notamment pas durant la longue période Jospin, le législatif ne parvint à reprendre la main ! | |
|
l'élection du président au Suffrage universel (votée en 62) appliquée pour la première fois en 65 ne put qu'accroître la préséance du président sur le chef de gouvernement. | |
|
Seule pouvait tempérer cette préséance la non concordance des mandats législatifs et présidentiels conduisant naturellement à une élection législative ( et donc à une possible remise en question politique) au cours de tout mandat présidentiel. De ce point de vue, on n'a pas assez mesuré, nous semble-t-il, les conséquences indirectes d'un mandat présidentiel à cinq ans, même si cette réduction sembla alors être justifiée à la fois par l'expérience et par l'accélération de la vie politique ! |
La présidence de Mitterrand, les trois cohabitations auront ainsi considérablement accentué la dimension présidentielle du régime au point qu'on a pu dire qu'aucun dirigeant républicain au monde ne dispose d'autant de pouvoirs sans contrepouvoirs ! Ce qui est sans doute exact !
La réduction, apparemment anodine au quinquennat et, surtout, la nécessité imposée par la loi que les présidentielles succèdent aux présidentielles, marquent définitivement le présidentialisme du régime, en interdisant, de fait, la possibilité d'une cohabitation, et d'une dissolution, sauf crise grave en cours de mandat ! En conséquence le législatif se voit désormais privé d'un levier de pression sur l'exécutif. Ce que, vraisemblablement la droite comprit avant la gauche
L'objectif affiché de cette réforme est ainsi de renforcer les pouvoirs du parlement qui aura eu tendance à ne plus être qu'une simple chambre d'enregistrement !
La réforme concerne 47 articles – sur 89 – de la Constitution de 1958. :
|
la limitation de la présidence à deux quinquennats consécutifs ; | |
|
la possibilité pour les ministres élus avant leur entrée au gouvernement de retrouver automatiquement leur siège, sans le remettre en jeu ; | |
|
l’introduction du référendum d’initiative populaire ou parlementaire ; | |
|
la reconnaissance des langues régionales et la promotion de l’égalité hommes-femmes ; la garantie de « l’indépendance » et du « pluralisme » de la presse. | |
|
L’article 49-3, qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote, voit son usage limité au budget de l’Etat et de la Sécurité sociale, et à un texte par session | |
|
la maîtrise par la Chambre de la moitié de l'ordre du jour dont un jour pour l'opposition |
Sous réserve que les pratiques politiques peuvent donner un avenir à ces réformes ou au contraire les vider de tout contenu, on remarquera que cette modification touche à plusieurs points importants :
|
la maîtrise partagée de l'ordre du jour donne virtuellement aux chambres la possibilité de bloquer les initiatives gouvernementales, ce que les chambres de la IIIe firent à de multiples reprises et qui entraînait la démission du gouvernement. Ne donner qu'une partie de cette maîtrise, c'est laisser à l'exécutif une marge de manœuvre sans doute suffisante. L'objectif est manifestement d'empêcher l'un de prendre le pas sur l'autre ! | |
|
la possibilité pour le président de s'adresser au Congrès
semble être contrebalancée par la limitation à deux mandats. En réalité la
concession est de peu d'importance: seul Mitterrand put achever deux
septennats; Chirac ne termina le second que parce que n'était plus qu'un
quinquennat. On peut aisément le comprendre : il est peu probable que le
même homme puisse incarner les aspirations majoritaires plus de dix années
consécutives sans même évoquer le syndrome du second mandat,
traditionnellement plus inerte, conservateur que le premier. L'adresse au
Congrès est plus ambiguë : en soi, pour autant qu'elle ne donne lieu à aucun
vote ni débat ne nuit pas plus qu'autre chose à la légitime séparation des
pouvoirs, d'autant, on l'a vu, que l'interdiction pour le président de
pénétrer dans une enceinte parlementaire avait quelque chose de
circonstanciel ! Pour autant il est assez obscur que le président cherche à
s'adresser au parlement dans la mesure où il y a un porte-parole naturel en
la personne du Premier Ministre. |
Comme toujours, l'imputation politicienne peut être avancée, ou la sincérité imparable ! Avec un peu d'optimisme on peut toujours espérer que le corps politique saura anticiper les éventuelles menaces ou au moins atténuer les aspérités des menaces potentielles d'une telle réforme ! On peut aussi craindre que la classe politique se couche devant le puissant du jour, comme elle a déjà montré savoir le faire (ne penser qu'à ces jours sombres de Juillet 40 où la Chambre du Front Populaire, certes amputée des députés communistes et de ceux qui étaient au front, mais la Chambre de 36 quand même, ne trouva que quelques quatre-vingt députés pour sauver l'honneur et refuser de voter les pleins pouvoirs à Laval et Pétain !
Comparaison n'est pas raison, certes , et il faudrait beaucoup de mauvaise foi pour confondre homme providentiel et hyperactif ! Il n'empêche que l'actuel hôte du palais de l'Elysée a trop la culture de l'action et du résultat, trop peu de patience politique pour ne pas bousculer le rythme, nécessairement lent, du débat républicain, parlementaire.
C'est bien ceci qui inquiète: derrière l'apparente restauration des prérogatives parlementaires et le respect proclamé pour nos institutions, que se glisse quelque chose comme un causez toujours ! moi, pendant ce temps, j'agis !
C'est toute la question, c'est tout le débat !
Notre histoire depuis 89 s'est presque toujours refusée au césarisme, refusant que le destin de la Nation fût assumé par un seul ! En laissant se dérouler le débat, mais en se mettant dans la position de n' avoir jamais à en tenir compte, Sarkozy tourne le dos à l'âme de la république !
![]()
 |
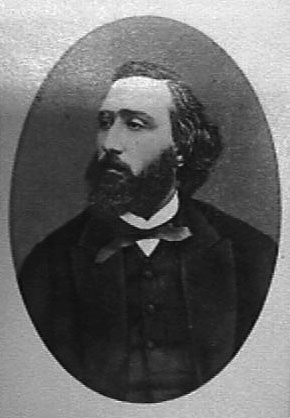 |