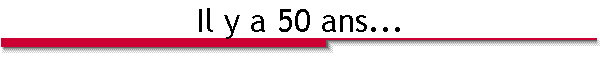
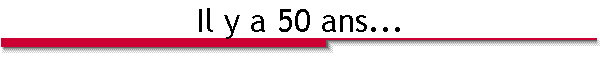
|
|
 |
Il y a 50 ans : les débuts de la Ve RépubliqueAnniversaire occulté, pour le moment, par celui de mai 68, événement, pourtant, autrement plus décisif de notre avenir, au moins en ceci qu'elle prévaut encore, la constitution a 50 ans ! Récemment modifiée, sans qu'il soit encore possible de déterminer si c'est de manière radicale ou non, cette constitution qui est quand même la 15e, se sera finalement caractérisée par son extrême souplesse, ayant pu s'adapter à la fois aux périodes tendues des débuts, notamment de la crise algérienne ou à la cohabitation, désignant que sa figure si particulière d'hybride : ni totalement présidentielle, ni véritablement parlementaire, cette constitution a, pour d'autres raisons que celle de 1875, assuré sa réussite - n'est-elle pas après tout, désormais, la seconde pour sa longévité? - par son ambivalence même. Adoptée par référendum 1, ce qui lui donna l'onction de la souveraineté nationale et effaça les conditions douteuses du 13 mai , modifiée substantiellement en 62 par l'élection du président au suffrage universel, même si cette disposition était en germe dans la version de 58 - on en trouve déjà trace dans le discours de Bayeux du 30 juin 46 -, elle le fut derechef, sans qu'on s'en rendît toujours immédiatement compte, par l'adoption du quinquennat qui fait nécessairement se coïncider législatives et présidentielles et rend ainsi quasi impossible un conflit entre les deux pouvoirs. A sa façon, elle ressemble à celle de 75 :
On peut vraisemblablement en tirer plusieurs leçons :
|
Les 15 textes constitutionnels sont accessibles sur le site du Conseil Constitutionnel
1) revoir
on peu retrouver le discours du 4 Septembre 58 place de la République ici :
«Discours place de la République (04 Sept. 1958)»
L''arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958
2) sur la crise de mai 77
|
Après les législatives des 20 février et 5 mars 1876, la Chambre des députés élue pour quatre ans dans le cadre des nouvelles institutions est composée d’une majorité de républicains. Jules Simon, républicain modéré, devenu Président du conseil après la démission de Jules Dufaure considéré comme trop à droite par les députés, règle le problème des pouvoirs financiers des assemblées en précisant que si celles-ci ont des pouvoirs législatifs identiques, les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la Chambre des députés, c’est à dire avant le Sénat. Jules Simon doit faire face à une agitation de l’épiscopat appelant à une intervention de la France contre l’Italie et à un « retour » de Rome à l’Église catholique. Gambetta interpelle le gouvernement le 4 mai 1877 sur le danger qui menace la République : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! » Il est acclamé par la gauche remobilisée. Après le vote d’une loi sur la presse, le Président de la République Mac- Mahon souhaite un changement de gouvernement. Le 16 mai 1877, dans une lettre au Président du Conseil, Jules Simon, le Chef de l’État lui demande s’il a le sentiment d’avoir toujours sur la Chambre des députés « l’influence nécessaire pour faire prévaloir ses vues. » Les députés républicains considèrent cette admonestation comme un abus de pouvoir contre le suffrage universel et la République. [Lien Intervention Léon Gambetta] Jules Simon démissionne. Mac-Mahon désigne le duc Albert de Broglie comme son successeur, marquant ainsi un retour à une politique d’ordre moral. La Chambre des députés adopte en réponse à son ajournement prévisible un manifeste signé par 363 de ses membres. Mac-Mahon prononce la dissolution de la Chambre des députés, après avis conforme du Sénat le 25 juin. Les élections des 14 et 28 octobre sont un succès pour les républicains qui reviennent à 321, conservant la majorité des sièges et des voix (4,2 millions de suffrages en faveur des républicains, contre 3,6 pour les monarchistes et les bonapartistes). Lire l'intervention de Léon Gambetta à la Chambre des députés, le 17 mai 1877
|