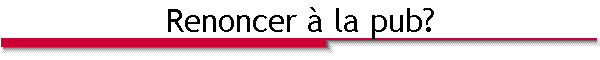
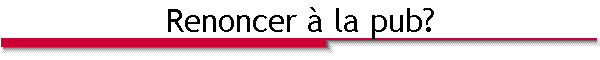
|
|
|
|
Une histoire, loin d'être achevée, d'une réforme ambivalente, ratée dès l'origine.
Une annonce à la sauvette ? une annonce surprise en tout cas !
Deux points méritent d'être notés dans cette logique de l'effet d'annonce:
Sur le premier point, que dire ? sinon que c'est vouloir donner à cette réforme une importance qu'elle n'a sans doute pas et que son apparente impréparation ne justifie en tout cas pas ! Sur le second, qu'il s'agit évidemment d'un assez joli tour de passe-passe ... tant qu'on n'y regarde pas de trop près ! Si la gauche, en son temps, renonça à cette réforme, c'était peut-être aussi parce qu'elle s'avérait poser plus de problèmes qu'elle n'en résolvait ! De la publicitéElle m'a toujours semblé posé trois types de questions :
De la TV comme service publicDes trois missions originairement confiées à la TV (informer, cultiver, distraire) on sait bien que la seconde est restée lettre quasi morte et que la première est toujours fragile ! Pour autant la multiplication des chaînes - notamment du service public - auront offert des espaces possibles à la culture sans que pour autant celle-ci se fût enfermée dans un quelconque ghetto ! Il n'est pas faux que la non soumission directe de la TV publique aux impératifs de l'audience, lui permettra toujours d'oser plus et mieux que ne le pourra jamais une TV privée : un opéra diffusé à la TV, même s'il ne fait que 300 000 spectateurs en fera toujours 10 fois plus que le même opéra en salle ! Le service du public c'est cela aussi ! Pour autant il ne faut pas tomber dans le piège de réserver la qualité au service public : il y a bien eu déjà de bons programmes sur les chaînes privées ! L'argument utilisé par Sarkozy est donc bien fallacieux, au sens précis du terme : il vise à induire en erreur ! On y retrouve l'argument apparemment imparable, faussement évident : tv publique/ressources publiques; tv privées/ ressources privées ! Avec à côté un autre parallèle bien plus ambigu encore public/qualité et privé / quoi ? (quantité ou daube infâme? ) ! Mais s'est-on seulement mis d'accord, au préalable, sur ce que l'on entend par qualité ? Et d'ailleurs, le peut-on seulement ? Renoncer, par avance, aux imputations politiciennes, voire aux suspicions de favoritisme à l'égard des groupes privés, amis du président ! Il faut voir plus loin. Qu'une telle réforme arrange les Bolloré et autres Bouygues, sans doute ! mais ramener les fondements d'une réforme à de simples arrangements privés, serait vraiment ramener l'analyse politique à peu de choses ! La fin du modèle français?Héritage de l'immédiat après-guerre, héritage aussi de la Résistance qui avait su imprimer à la politique française quelques relents de gauche, le service public (de l'énergie à la santé en passant par la culture, la poste etc) offrait à l'Etat un champ d'action bien plus large que ses seules fonctions régaliennes à quoi les thèses libérales voudraient le voir réduire. On le sait, jusqu'aux années 75, jusqu'à l'offensive libérale initiée par un Reagan et Thatcher , la France suivit une stratégie dirigiste qu'elle abandonna progressivement sous les coups de buttoir de l'offensive libérale et ce, paradoxalement, sous des gouvernements de gauche: elle le fit en ouvrant à la concurrence des secteurs jusqu'alors réservés au service public avant de finalement les privatiser France Telecom reste un excellent exemple ... L'ouverture à la concurrence s'acheva inéluctablement par la disparition pure et simple du service public, par la privatisation. GDF fusionne avec Suez : comment ne pas redouter que, demain, l'Etat ne s'y débarrasse de ses intérêts comme il le fit déjà ? Qu'en pourrait-il être de la TV ?Une saine logique voudrait que la concurrence impliquât des moyens équivalents: donc des ressources publicitaires possibles pour les uns et les autres. Si l'on devait biaiser les règles de cette concurrence ce ne peut être que pour deux raisons:
La récente déclaration de Sarkozy indiquant que le président de la TV publique devait être nommé par l'exécutif plutôt que par le CSA semble indiquer que l'on veut aller dans ce sens. Outre que ce serait une régression en matière d'indépendance de l'information, on mesure surtout la contradiction qu'il y aura, en la matière, entre le credo libéral et cette volonté explicite de reprendre la main sur l'audio-visuel public; on devine encore l'insolence qu'il y aurait, pour l'exécutif, à vouloir définir à la place du public, ce qu'est un spectacle de qualité, on mesure surtout le paradoxe qu'il y aurait à lui permettre de définir pour son propre compte les critères d'indépendance.
Reste
la seule question qui vaille...
|
|
1e hypothèse: le pouvoir vise l'abandon du service public audio-visuel mais n'ayant pas les moyens politiques de le décider, il le programme par l'assèchement des ressources publicitaires de ce dernier ! | |
|
2e hypothèse : l'histoire, la prétention à l'universel de la France, sa tradition culturelle interdisent que notre aura disparaisse dans les entrelacs des conglomérats, fusions et autre OPA des grands groupes médiatiques internationaux ! Mais alors, la TV, parce qu'affaire de prestige, devient ipso facto affaire politique majeure ! |
Le fond de l'affaire est sans doute à rechercher dans notre rapport si ambigu au libéralisme (voir les récentes déclarations de Delanoë) : il semble bien que les anglo-saxons eurent toujours de la liberté une appréhension pragmatique - la liberté n'a de sens qu'au lieu où elle s'exerce, dans la cité - et donc en s'acharnant à la garantir politiquement en firent la condition même, indépassable, de toute activité économique. L'égalité, dans cette perspective, n'est plus véritablement au fondement du système, mais la résultante des efforts individuels que la liberté rend possible, mais ne garantit pas ! Alors que, dans la perspective de 89, l'égalité est constamment associée à la liberté : ce qui signifie aussi que l'économie est affaire politique et non que la politique soit affaire d'économie !